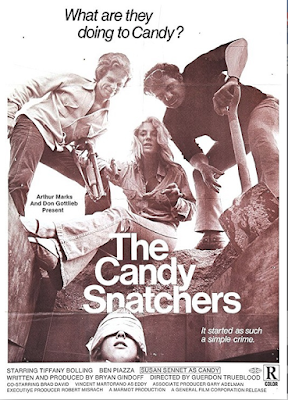Photo empruntée sur Facebook
de Luca Guadagnino. 2018. U.S.A/Italie. 2h32. Avec Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Chloë Grace Moretz, Angela Winkler, Ingrid Caven, Elena Fokina, Sylvie Testud.
Sortie salles France: 14 Novembre 2018. Italie: 1er Septembre 2018
FILMOGRAPHIE: Luca Guadagnino est un réalisateur scénariste et producteur italien, né le 10 août 1971 à Palerme en Sicile. 1999 : The Protagonists. 2001 : Sconvolto così. 2003 : Mundo civilizado (documentaire). 2004 : Cuoco contadino (documentaire). 2005 : Melissa P. 2009 : Amore. 2015 : A Bigger Splash. 2017 : Call Me by Your Name. 2018 : Suspiria. 2018 : Rio (postproduction). ? : Call Me by Your Name 2. ? : Blood on the Tracks.
Vilipendé par les fans indéfectibles du mastodonte cabalistique d'Argento (personnellement il s'agit du film de ma vie !) avant même sa sortie inévitablement controversée, Suspiria nouvelle mouture fait l'effet d'une bombe déroutante sitôt le générique écoulé. Dans la mesure où Luca Guadagnino nous cueille par la main 2h30 durant dans les entrailles d'un Enfer ésotérique avec un réalisme diaphane incroyablement perturbant. Ainsi, se démarquant de son modèle avec une ambition disproportionnée (ses détracteurs lui évoqueront une disgracieuse prétention), Lucas Guadgnino se réapproprie du matériau initial en y imprimant sa personnalité auteurisante. Et ce afin d'élever le genre horrifique à un niveau de grâce inouïe tout en y réfutant brillamment le copié-collé standardisé (rien que pour ça respect pour son audace et son intelligence hors-norme). Tant auprès du langage des corps contorsionnés lors de ballets baroques sensoriels que de son atmosphère feutrée à la fois sensiblement angoissante et malsaine que le spectateur redoute avec une irrévocable fascination contradictoire. Comme si lui même se retrouvait impuissant à la merci des 3 mères d'une vérité humaine délétère, de par leur regard fétide et leurs pouvoirs perfides. Il faut d'ailleurs remonter au chef-d'oeuvre indétrônable Rosemary's Baby (voir aussi à Lord of Salem) pour y retrouver une aussi flagrante expressivité à travers l'identité sournoise de sorcières décaties faussement avenantes !
Et donc à travers un cheminement narratif nébuleux où y évoluent des personnages équivoques, pour ne pas dire sibyllins (je m'y suis d'ailleurs perdu lors de son dernier quart d'heure abscons pour les diverses mutabilités identitaires), Suspiria parvient à l'aide de sa vénéneuse atmosphère anxiogène à magnétiser l'attention du spectateur dans une forme alchimique et viscérale parfois proche du malaise. Tant auprès de l'atrocité de meurtres graphiques d'une souffrance insupportable (la mise à mort liminaire d'une des danseuses et le sabbat orgasmique faisant office d'anthologies à marquer d'une pierre noire) que de l'aspect cérébral pour la caractérisation démunie des danseuses à la merci des sorcières impérieuses. Et donc, on a beau se perdre dans la confusion de son intrigue sinueuse faisant notamment intervenir les fantômes du nazisme (le Dr Jozef Klemperer hanté par la disparition de son épouse anciennement déportée) et le terrorisme de la bande à Baader durant leur prise d'otages vers la fin des seventies, on reste scotché à l'écran de par son esthétisme grisonnant (tant auprès de l'enceinte nécrosée de l'école que des extérieurs urbains) où tout semble livré à la merci d'un Mal austère. En background, on peut d'ailleurs y déduire à travers les connivences de cette caste féministe à la fois autonome et cynique une certaine métaphore sur l'émancipation féminine durant la période frondeuse des années 70.
*Bruno
Ci-joint en exclusivité, la chronique de Jorik V
A ceux qui pensent que les remakes de films d’horreur sont condamnés à être broyés dans le moule hollywoodien et aseptisés à l’extrême dans un but mercantile en seront pour leur argent avec ce « Suspiria ». Luca Guadagnino réussit à apposer sa patte et sa vision au film culte de Dario Argento faisant de ce « Suspiria » nouvelle génération un sommet d’épouvante et d’horreur en tous points qui ne ressemble à rien de connu et c’est tant mieux. Dans le genre horrifique, on se souvient à la limite du remake de « Massacre à la tronçonneuse » de Marcus Nispel qui parvenait à faire entendre sa propre voie dans une version gore et sans concession d’excellente mémoire. Mais ici, c’est tout autre chose. On est dans un film d’auteur pur jus auxquelles les visions de terreur et l’ambiance malsaine donnent une patte encore plus singulière à une bobine hors du temps. Et on ne peut que saluer le cinéaste qui passe en un an du chef-d’œuvre romantique et éthéré « Call me by your name », chronique sentimentale gay et intello inoubliable, à ce film fantastique où seule la trame et l’histoire générale du film culte de Dario Argento sont reprises mais fondues dans une vision totalement neuve et impressionnante par sa radicalité. Alors peut-être que cette version peut sembler chargée pour les fans de l’original qui était plus un simple film d’horreur, un giallo comme on disait à l’époque, ayant acquis sont statut culte davantage pour ses qualités formelles et ses exubérances esthétiques. Ici, Guadagnino emmène le spectateur dans une histoire qui convoque la Seconde Guerre Mondiale, la bande à Baader, le féminisme actuel et même l’ascétisme Amish ! C’est parfois un peu trop fort en symbolisme et « Suspiria » 2018 pourrait être désigné par certains comme un film prétentieux à tous niveaux. On choisira plutôt de scanner cette relecture comme un proposition de cinéma inédite, audacieuse et passionnante dont on ne réussira pas toujours à déceler les signes et ponts dressés lors de la première vision. Tout comme certaines clés de l’intrigue resteront opaques, notamment dans le dénouement et le but réel des incantations des sorcières. C’est donc parfois frustrant mais totalement addictif à tel point qu’on a envie de vite revoir le film pour en saisir certaines nuances. Mais ce mystère qui entoure l’intrigue et dont une partie restera en suspens est finalement en totale adéquation avec les fondamentaux du fantastique et les velléités du cinéaste qui a conçu cette mosaïque comme un labyrinthe mental obsédant mais tout sauf limpide et confortable. Le seul réel reproche que l’on pourra apporter au film est sa durée hors de toute logique pour un film de ce genre (plus de deux heures et demie !) et que, par ricochet, sa première demi-heure patine. C’est effectivement long à démarrer et on se dit qu’on est parti pour une projection pénible, mais il ne faut justement pas lâcher au regard de ce qui nous attend après et du film dans sa globalité. Loin de tous les sursauts de bas étage en cours dans la plupart des films d’horreur et d’épouvante actuels généralement bas de gamme, Guadagnino préfère instaurer une atmosphère délétère, malsaine et putride qui nous colle aux basques dès les premières images. Nous faire sursauter, il n’en a cure. Il préfère nous mettre mal à l’aise et nous offrir sporadiquement des visions d’horreur totalement délirantes. La première, où on voit le corps de cette danseuse en fuite malmené jusqu’à l’écœurement accroche l’œil durablement et nous remue les tripes. Quant à l’orgie horrifique et sanglante finale, si elle aurait pu sombrer dans le grand-guignol et le risible, elle nous scotche à notre siège grâce à cette ambiance répugnante et tous ces personnages fous à lier. C’est un choc, certainement l’une des séquences les plus folles au cinéma cette année. Encore pire, car plus dingue et surréaliste que la seconde partie de « Climax ». Guadagnino y va même un peu fort (il a du mal à contrôler les effusions de sang et certains délires de caméra) mais les visions d’épouvante qu’il nous inflige durant quinze minutes glacent d’effroi à tel point qu’on est content lorsque ça se termine. Un peu l’opposé de la sublime séquence de danse précédente qui range « Black Swan » au rayon crèche et nous hypnotise complètement. D’ailleurs ici la danse est un vecteur puissant de l’intrigue, parfaitement intégré à l’image. En plus de ses plans très travaillés et d’une mise en scène pleine de tours de passe-passe, le cinéaste transalpin réussit un monument de terreur, unique en son genre, qui divisera certainement. Mais « Suspiria » ne laissera personne indifférent par son fond très dense et les visions inédites qu’il propose. Les sorcières n’auront jamais autant fait peur ! Plus de critiques cinéma sur ma page Facebook Ciné Ma Passion.
La chronique du site "Avoir-alire":
Une relecture passionnante et oppressante du chef d’oeuvre d’Argento qui distille une angoisse permanente avec ses corps malmenés et son atmosphère malsaine. Un véritable tour de force.
Notre avis : Dire que l’on redoutait le projet, c’est un euphémisme. Pourquoi donc oser s’en prendre au chef d’oeuvre magnétique de Dario Argento ? En intégrant le surnaturel au giallo dont il se rendit maître après Mario Bava, Argento transcendait son style avec une œuvre hypnotique et effrayante dont l’esthétique reste incomparable.
Son film, comme chacun s’en doute, a marqué et inspiré de nombreux cinéastes. Luca Guadagnino est de ceux-là, lui qui fut tout d’abord frappé par l’affiche à l’âge de 10 ans. Quand il découvre enfin le film à l’adolescence, c’est une révélation autant qu’un choc esthétique, et déjà il se rêve en réalisateur qui proposerait sa propre version de l’oeuvre d’Argento et de Daria Nicolodi, scénariste, avec le maître, de l’original. Alors quand, il y a plus de 10 ans, il se met à penser le projet avec son producteur, c’est un rêve d’enfant qui se réalise.
En revanche, pour tous les cinéphiles et surtout les admirateurs du cinéaste Argento, c’est un peu le cauchemar. Déjà parce que le film n’a nul besoin d’être refait ou modernisé, c’est une bulle de cauchemar intemporelle dont l’esthétique si particulière fascine encore. Et puis, l’idée d’une version emmenée par le réalisateur du pourtant célébré Call me by your name ou encore A Bigger splash (déjà la relecture d’un classique de Jacques Deray, La Piscine, et déjà écrit par David Kajganich, scénariste sur ce nouveau Suspiria) avait de quoi largement inquiéter.
Et pourtant, le cinéaste, visiblement passionné par son sujet, réussit finalement à se détacher de l’oeuvre originale avec une vision radicale. Il déplace l’intrigue, initialement située à Fribourg, dans le Berlin de 1977, soit l’année de sortie du Suspiria d’Argento. De fait, il ouvre cette histoire qui se déroulait en vase clos aux remous politiques d’une ville coupée en deux, sous le coup de la guerre froide et des attentats politiques de la bande à Baader .
L’intrigue, découpée en 6 actes, suit toujours une jeune américaine venue pour intégrer une compagnie de danse, qui se révèle être un repère de sorcières et dont la fameuse Helena Markos, qui donne son nom à la troupe, serait la « Mère Supérieure ».
Dakota Johnson, surtout connue pour la série des Cinquante nuances… mais qui a déjà travaillé avec Guadagnino (A bigger splash), trouve ici un rôle physique qui enfin lui donne l’occasion d’exprimer une palette de jeu plus intéressante. Tour à tour timide, apeurée puis volontaire et déterminée, son personnage n’est plus la silhouette qu’esquissait Jessica Harper (que l’on retrouve ici) mais un pilier pour le film et surtout le spectateur. Passée par un entraînement intensif à la danse contemporaine pendant de longs mois, elle livre une performance impressionnante, entre la danse et la possession démoniaque, deux facettes que le film explore.
Après un prologue qui instille l’atmosphère de sourde angoisse du long-métrage (amenée à exploser sur sa fin) et emmené par l’excellente Chloë Grace Moretz et le psychiatre qui sert de fil rouge à l’histoire autant qu’à incarner la rationalité du spectateur (interprété par… oh et puis non, découvrez-le vous-même), Suspiria entame une lente et progressive descente aux enfers.
Si le contexte politique, amorcé par les plans en extérieur sur le mur et développé par les nombreux reportages radio ou télévisés, reste plutôt théorique dans sa mise en scène, il a le mérite d’expliciter, à l’échelle historique, l’aliénation des corps et des esprits que subissent les gens de l’époque et ainsi, en miroir, celle des femmes qui viennent chercher dans la danse ou chez ces sorcières un pouvoir de libération total. Ce n’est sans doute pas un hasard si le réalisateur situe l’académie face au mur, souvent le film joue de cette frontière imposée à traverser, par le parcours du psychiatre surtout. Frontière que l’on retrouve à l’intérieur de l’académie, entre le visible et l’invisible, les locaux accessibles et les cachettes secrètes qui se dérobent.
La danse, si elle n’était qu’un décor dans l’original, est ici au coeur du film. Les ballets sont puissants, chorégraphiés avec précision par Damien Jalet, chorégraphe franco-belge, et développent la thématique visuelle de l’antagonisme entre puissance de vie et puissance de mort. À l’image de l’audition de Susie, en montage alterné avec une autre danseuse, ailleurs dans le bâtiment, spectaculaire et repoussante à la fois. Des liens surnaturels qui unissent les mouvements, avec d’un côté le pur spectacle de l’expression du corps et de l’autre l’effroi que celui-ci peut susciter lorsque l’on pousse la logique des mouvements extrêmes jusqu’au bout (lorsque l’on sait que Dakota Johnson elle-même a terminé aux urgences pendant le tournage d’une scène de danse où elle projette violemment son torse en arrière, on se dit que la séquence vaut aussi comme commentaire des violences que l’on s’inflige pour la beauté d’une performance artistique.)
Au dessus de tout cela, comme une ombre projetée sur les personnages avant qu’il soit évident qu’elle-même subit un pouvoir supérieur, il y a Madame Blanc, glaciale et tranchante mais aussi maternelle et qui suscite l’admiration de ses danseuses. Elle est la puissance hypnotique du film. Silhouette à la fois gracile, sèche et glaciale, Tilda Swinton ressemble à Pina Bausch. Le cinéaste s’est bien sûr inspiré de la célèbre chorégraphe allemande, mais aussi de Sasha Waltz, autre chorégraphe allemande que le scénariste David Kajganich suit et interroge longuement pour réussir à écrire ce personnage.
Si Madame Blanc paraît vampire à se nourrir des émotions suscitées par les danses de ses élèves, elle les libère aussi et surtout de la pesanteur – littéralement – d’un monde extérieur fait par et pour les hommes.
Et l’horreur dans tout ça ? Suspiria ne joue pas la carte de la frayeur. Il distille le malaise et l’angoisse le long d’un film qui se veut descendant des drames chocs de Fassbinder. C’est dans des inserts, des contrechamps ou des images brèves distillées dans un cauchemar que l’atmosphère s’épaissit, et ne rassure jamais.
Le film s’éloigne donc du style de son modèle, mais privilégie lui aussi son atmosphère. Hors de question de tenter de reproduire la photographie de Luciano Tovoli, qui à l’aide du Technicolor composait son image avec les couleurs primaires. Ici, Sayombhu Mukdeeprom, déjà à l’oeuvre sur Call me by your name et responsable de la très belle photographie d’Oncle Boonmee d’Apichatpong Weerasethakul, choisit avec son réalisateur les couleurs du Berlin gris et froid des années 70. Relevé de quelques verts pâles et marrons terreux, l’ensemble évoque en effet certains films de Fassbinder dont ils se sont inspirés, mais aussi des peintures de Balthus.
Le rouge quant à lui survient par petites touches, autant d’indices visuels qui annoncent le final, notamment dans la séquence du ballet avec ces cordelettes rouges nouées sur le corps des actrices qui évoquent évidemment la pratique du bondage, à nouveau cette opposition visuelle entre corps empêché et corps délivré.
La musique de Thom Yorke, leader du groupe Radiohead dont c’est la première bande originale, vient nimber le tout d’une mélancolie étonnante, avec ses chansons magnifiques au piano sur lesquelles se pose sa voix hantée, et contribue à distiller l’angoisse par ses nappes de synthé tantôt indus, tantôt aériens.
Guadagnino explore l’ambiguïté humaine, son côté sombre, mis en scène dans cette micro société de femmes qui voudrait échapper à un monde violemment patriarcal. Des femmes, il célèbre aussi la puissance mais, comme toute puissance, il montre l’envers ténébreux, destructeur.
S’il ménage quelques séquences de body-horror éprouvantes, le film évite pendant une bonne partie la surenchère. Il culmine cependant dans un final rouge qui serait le versant grand-guignol de Climax, signe du jusqu’au boutisme d’un cinéaste qui n’a pas peur de sombrer en cours de route (et réussit à passer en force !). Un rituel païen que l’on peut voir comme une reprise (ou correction) d’une séquence similaire de Mother of tears d’Argento, la pitoyable conclusion de sa trilogie des Trois Mères entamée donc par Suspiria et poursuivie par le beau Inferno.
Suspiria est donc une « reprise », pour employer le mot de Tilda Swinton, absolument passionnante qui n’a pas longtemps à souffrir d’une comparaison avec l’original. Un travail incarné qui, s’il s’éloigne de son modèle, sait lui rendre hommage en reprenant et actualisant quelques séquences. On ne criera pas non plus au chef-d’oeuvre, l’ensemble est un peu trop long et le rythme parfois lambine, mais on peut le célébrer comme étant une véritable réussite, même un tour de force compte tenu de tous les risques évoqués plus haut.