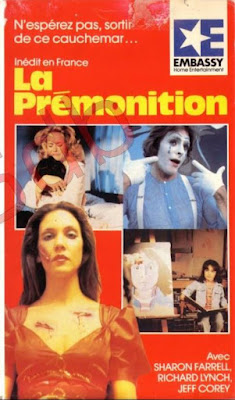Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com
de William Friedkin. 1987. U.S.A. 1h31 (montage de 92). Avec Michael Biehn, Alex McArthur, Nicholas Campbell, Deborah Van Valkenburg, John Harkins, Art LaFleur, Billy Green Bush.
Sortie salles France: 23 Novembre 1988. U.S: 30 Octobre 1992
FILMOGRAPHIE: William Friedkin est un réalisateur, scénariste et producteur de film américain, né le 29 août 1935 à Chicago (Illinois, États-Unis). Il débute sa carrière en 1967 avec une comédie musicale, Good Times. C'est en 1971 et 1973 qu'il connaîtra la consécration du public et de la critique avec French Connection et L'Exorciste, tous deux récompensés à la cérémonie des Oscars d'Hollywood. 1967: Good Times. 1968: l'Anniversaire. 1968: The Night they Raided Minsky's. 1970: Les Garçons de la bande. 1971: French Connection. 1973: l'Exorciste. 1977: Le Convoi de la peur. 1978: Têtes vides cherchent coffres pleins. 1980: The Cruising. 1983: Le Coup du Siècle. 1985: Police Fédérale Los Angeles. 1988: Le Sang du Châtiment. 1990: La Nurse. 1994: Blue Chips. 1995: Jade. 2000: l'Enfer du Devoir. 2003: Traqué. 2006: Bug. 2012: Killer Joe. 2023: The Caine Mutiny Court-Martial.

Dressant le glaçant portrait d'un tueur en série (Alex McArthur sidérant de flegme et de force tranquille derrière son sourire désarmant de naturel !) dans une facture documentée criante de vérité, le Sang du Châtiment est une oeuvre à la fois malsaine et malaisante nous questionnant sur la polémique de la peine de mort. Conjuguant suspense à l'ambiance un tantinet horrifique, drame psychologique pour l'attention accordée à la fragilité des victimes survivantes et à la remise en doute du procureur puis film de procès, le Sang du Châtiment demeure suffisamment passionnant, dense, sciemment ambigu à savoir si un tueur sadique est potentiellement fou ou sain d'esprit après avoir commis l'innommable. Sachant que s'il plaide la folie il pourrait un jour retrouver sa liberté après avoir purgé quelques années en centre psychiatrique. Et si le film laisse des traces dans l'encéphale c'est également grâce à son ambiance lourde, oppressante, déstabilisante, comme habitée par le Mal si j'ose dire et irriguant tout le récit parmi l'extrême maîtrise de la réalisation de Friedkin entièrement voué à ses personnages se remettant mutuellement en cause sur les valeurs du Bien et du Mal. Le score quasi dépressif d'Ennio Morricone renforçant ce sentiment insécure que l'on perçoit à travers son aura implicite de désespoir existentiel. Un film choc donc dont on ne sort pas indemne passée son amère conclusion dénuée d'illusion.
Ci-joint ma chronique de 2011
Définition: La peine de mort ou peine capitale est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de « crime capital ». La sentence est prononcée par l'institution judiciaire à l'issue d'un procès.
La peine de mort aux États-Unis est appliquée au niveau fédéral et dans trente-cinq États fédérés sur cinquante que comptent le pays. Aujourd'hui, les États-Unis font partie du cercle restreint des démocraties libérales qui appliquent la peine de mort.
La peine de mort est diversement considérée selon les époques et les régions géographiques. A l'origine, peine très fortement développée à travers le monde, elle a été déconsidérée à l'époque des Lumières. Fortement en recul dans la deuxième moitié du XXe siècle, elle est actuellement dans une situation incertaine.

Deux ans après
Police Fédérale, Los Angeles, polar high-tech transcendant la ville californienne pour jonglant sans cesse autour des valeurs du Mien et du Mal, le pourfendeur
William Friedkin lance un nouveau pavé dans la mare avec
Le Sang du Châtiment. Un pamphlet à double tranchant sur l'épineux débat de la peine de morte suggéré chez un accusé capable de commettre les plus abominables des crimes au nom de la folie ou de sa raison.
Au hasard d'une demeure familiale, un inconnu accoutré de lunette noire et d'une veste rouge sonne à la porte et tire sans sommation sur sa logeuse âgée. A l'intérieur de la maison, il continue son massacre en mutilant les parents de la propriétaire. Un peu plus tard, il continue sa virée meurtrière en assassinant une mère de famille retrouvée découpée en morceau et de son fils mystérieusement disparu. Appréhendé par les forces de l'ordre, le tortionnaire semble totalement dénué d'un quelconque remord et possède même un mobile sur ses exactions sanguinaires.
Oeuvre maudite sujette à dérangeante controverse et devenue depuis introuvable en support numérique, Le Sang des Châtiments est le genre de métrage antipathique que l'on n'ose à peine aborder, faute de son sujet scabreux beaucoup trop complexe et abstrait mais si essentiel et capital. D'après le roman "Rampage" de William P. Wood, (ancien avocat de la défense et co-scénariste du film), le Sang du châtiment s'inspire en partie d'un fait divers réel vis à vis du "Vampire de Sacramento". Un tueur en série américain, de son vrai nom, Richard Case, ayant sévit durant les années 70 pour se repaître du sang de ses victimes. Dans un climat glaçant et malsain renforcé d'une photographie blafarde et d'un score musical aigri, le prologue de cette éprouvante descente aux enfers tétanise d'effroi le spectateur avec l'estocade d'un inconnu agressant de manière aléatoire d'innocentes victimes confortablement installées dans leur cocon familial. Sans jamais verser dans une quelconque débauche outrancière, le caractère ultra réaliste des meurtres abjectes mis en exergue dans une âpre verdeur nous terrifie. Car elle touche de plein fouet l'image chétive du citoyen lambda paisiblement réuni dans sa demeure alors qu'un étranger d'apparence docile décide de faire brutalement irruption pour faire voler en éclat leur existence épanouie. Après un second massacre perpétré auprès d'une famille sans histoires, la narration entre de plein gré dans le vif du sujet en appréhendant furtivement le tueur qui n'oppose aucune résistance face aux forces de l'ordre. S'ensuit une expertise médicale et psychiatrique avant que l'accusé ne se retrouve assigné derrière les barreaux devant un tribunal mené par un procureur pro-peine de mort. En effet, il faut rappeler que ce jeune avocat est douloureusement affecté par la perte chère de sa fille décédée 6 mois auparavant d'une brutale pneumonie. Ce lourd sentiment intrinsèque d'injustice va inévitablement l'influencer à condamner sévèrement son accusé en prouvant qu'il était sain d'esprit au moment de ces exactions. Mais le tueur prénommé Charlie Reece aura su démontrer aux experts en psychiatrie que ses ambitions meurtrières étaient pleinement justifiées par son besoin vital de se repaître du sang de ses victimes afin de purifier son enveloppe corporelle avilie. Paradoxalement, la rupture conjugale inopinée de l'épouse de l'avocat va le remettre finalement en question, à savoir s'il faut véritablement envoyer l'accusé à la chambre à gaz. Mais un revirement fortuit va empêcher la décision capitale à trancher si oui on non, ce tueur atypique méritait la peine de mort.

Mis en scène de manière brute et traversé par la hantise d'images cauchemardesques titillant l'esprit du spectateur, Le Sang du châtiment est un terrifiant constat sur le délicat parti-pris d'envoyer ou réfuter au bûcher un tortionnaire responsable d'ignobles crimes perpétrés envers des quidams. Si le film dérange aussi viscéralement, nous place dans un sentiment déstabilisant d'inconfort et ne nous laisse pas indemne à la fin de la projo, c'est dans notre éthique déterminante à approuver ou non la peine de mort chez le prévenu condamné. Si cet homme considéré comme dérangé mental par nos psychiatres notoires est apte à être soigné dans un institut spécialisé durant un laps de temps indéterminé pour peut-être un jour prochain retrouver sa liberté alors que ses victimes immolées auront péri dans d'abominables souffrances. Se pose évidemment la question toute aussi rigoureuse de la récidive si ce tueur lavé de ses pêchers décide en dernier recours à renouer avec l'homicide. Dans le rôle impassible implicitement cynique du tueur au visage angélique, Alex McArthur est proprement sidérant de froideur, d'ambiguïté et de flegme monolithique. Il peut même concourir aux portraits des plus terrifiants serial-killers au cinéma.
Imprégné d'une ambiance malsaine infectant la pellicule de Friedkin dans son portrait établi envers un tueur en série équivoque glaçant de naturel, Le Sang du Châtiment est une oeuvre choc dont il est difficile d'en sortir indemne. La force de son brûlot pro-peine de mort (pour finalement se reconvertir en désespoir de cause) n'apportant aucune solution rédemptrice afin de laisser au spectateur sa théorie en suspens. En résulte un psycho drame d'une horreur moite et sufficante dans sa quête de nous interroger sur l'enjeu humain d'un abominable meurtrier victime de son existence anonyme. *Bruno
3èx










 c
c









..JPG)