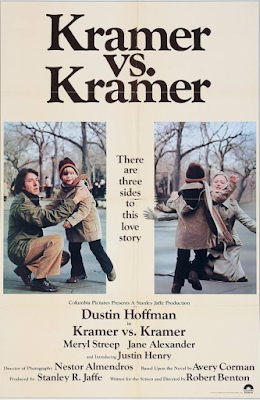Photo empruntée sur Google, appartenant au site fan-de-cinema.com
"Long Weekend" de Colin Egleston. 1978. Australie. 1h32. Avec John Hargreaves, Briony Behets, Mike McEwen, Roy Day, Michael Aitkens.
Sortie salles France: 30 Juillet 1980. U.S/Australie: 29 Mars 1979
FILMOGRAPHIE: Colin Eggleston est un réalisateur australien, né le 23 Septembre 1941 à Melbourne, décédé le 10 Août 2002 à Genève. 1977: Fantasm Comes Again (pseudo Eric Ram). 1978: Long Week-end. 1982: The Little Feller. 1984: Innocent Prey. 1986: Cassandra. 1986: Dakota Harris. 1986: Body Business (télé-film). 1987: Outback Vampires.
En 1978 sort sur les écrans un modeste film australien au budget dérisoire sous l'égide d'un metteur en scène néophyte dirigeant brillamment 2 comédiens d'autant plus méconnus. A la surprise générale les récompenses pleuvent à contrario de son accueil glacial reçu dans son pays natal ! Antenne d'Or à Avoriaz, Prix Spécial du Jury, Prix de la Critique au Rex de Paris, Meilleur Film, Meilleur Acteur pour John Hargreaves et enfin Prix du Jury à Sitges ! Rien que ça ! Quelques décennies plus tard et un remake amorcé, ce chef-d'oeuvre écolo (terriblement actuel !) garde intact son pouvoir de fascination émanant d'un environnement naturel à la fois follement anxiogène et malsain. Un jeune couple sur le déclin tente de se réconcilier en passant un long week-end dans une nature sauvage à proximité d'une plage. Après avoir planté leur tente sur un bout de terrain vierge, des évènements naturels inexpliqués se produisent et semblent intenter à leur vie !
Avec une économie de moyens et sans aucune outrance spectaculaire, Long Week-end nous intrigue fort habilement en distillant une peur anxiogène par le truchement d'une intrigue d'une rare originalité. Un couple en dérive conjugale tente de s'offrir une seconde chance en pliant bagage vers une destination bucolique le temps d'un week-end. Après avoir planté un univers écolo déjà étrangement atmosphérique, un soin consciencieux est établi auprès de la caractérisation du couple antipathique n'assumant aucune considération pour la faune et la flore. Le mari obtus, adepte de la chasse et des loisirs du camping, passant son temps à inspecter les alentours d'une végétation florissante avant de s'exciter à décharger aussitôt quelques cartouches de fusil sur des volatiles ou mammifères errants. Sexuellement frustrée et irascible pour cause d'avortement et d'adultère, la mégère s'ennuie lamentablement tant et si bien qu'elle se contente de se dorer la pilule au soleil en lisant des magazines érotiques. Totalement impassible à la beauté naturelle du climat bucolique, elle s'avère encore plus irrévérencieuse et haïssable que son époux. Ainsi, après que ce dernier eut été agressé par un rapace, elle écrasera un oeuf fécond contre un arbre par simple rancune.
Lentement, leur rapport préalablement conflictuel s'exacerbera un peu plus faute d'évènements intrigants découlant du danger sous-jacent de bruit d'animaux tantôt affolés, tantôt éplorés. Mais après que des mammifères eurent été sacrifiés et son massif forestier violé, la nature insidieuse décidera de prendre sa revanche sur ces oppresseurs afin de leur faire payer leur impudence. Ainsi, l'intensité progressive de Long Week-end découle de cet enchevêtrement de comportements primaires perpétrées par deux quidams immatures (pour ne pas dire irresponsables) car extériorisant leur colère, leur caprice et leur ingratitude sur la nature vierge. L'ambiance anxiogène qui y émane, le climat dépressif émanant de leurs rapports péniblement houleux, le sentiment d'insécurité instauré par moult évènements imbitables nous confinant vers un climat malsain d'une puissance visuelle assez claustro. A cet égard, la dernière partie, course de survie pour le couple déboussolé, renforcera ce sentiment oppressant de menace indicible pour autant littéralement prégnante, pour ne pas dire ensorcelante. Le spectateur assistant impuissant à leur fatigue et lassitude morales sous l'impulsion d'une dramaturgie escarpée à l'humour noir abrasif. Trois séquences génialement ubuesques faisant office d'anthologie à travers leur ironie sardonique que le spectateur éprouve néanmoins avec une certaine compassion, de par la mentalité pathétique du duo en perdition. Et donc en épargnant continuellement l'esbroufe, Colin Egleston cultive avec une rare subtilité (notamment auprès de sa puissance formelle ensorcelante, j'insiste !) un cauchemar écolo aux cimes du fantastique où le malaise palpable s'accapare de notre psyché aussi désorientée que les antagonistes.
Un crime contre nature
Scandé d'une partition ombrageuse de Michael Carlos afin de soutenir l'angoisse en crescendo et brillamment incarné par 2 comédiens méconnus jouant les troubles-fêtes avec un naturel idoine, Long Week-end festoie autour du Fantastique le plus éthéré. L'effet de suggestion amorçant de manière si vénéneuse une terreur davantage implacable au coeur d'une végétation naturelle aussi hostile que feutrée. Chef-d'oeuvre auteurisant d'autant plus atypique et formellement vertigineux, Long week-end laisse en état de transe sitôt le générique bouclé, et ce en nous interrogeant notamment sur la cause animale et dame nature vulgairement maltraitées par le plus grand prédateur que la planète eut connu: l'homme !
* Bruno
16.10.18. 4èx
10.01.12 (789 vues)
Récompenses: Prix Spécial du Jury, Prix de la critique au festival du Rex à Paris en 1979.
Antenne d'Or au Festival d'Avoriaz en 1979.
Meilleur Film, Meilleur Acteur (John Hargreaves), Prix du Jury de la critique internationale de Sitges en 1978.