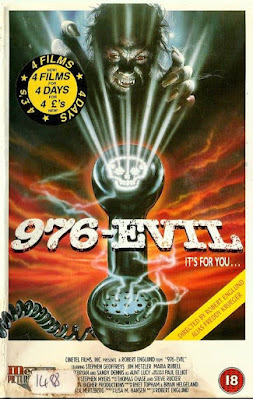de Ti West. U.S.A. 2011. 1h41. Avec Sara Paxton, Pat Healy, Kelly McGillis, George Riddle, Lena Dunham, Alison Bartlett, John Speredakos, Jake Schlueter.
Sortie U.S: 3 Février 2012. Sortie France (direct en dvd): 28 Août 2013.FILMOGRAPHIE: Ti West est un réalisateur, producteur, éditeur et scénariste américain né le 5 Octobre 1977. 2001: The Wicked. 2005: The Roost. 2007: Trigger Man. 2009: Cabin Fever 2. The House of the Devil. 2010: Perdants Take All. 2011: The Innkeepers.
En 2009, Ti West surprit les puristes fantasticophiles avec House of the Devil pour son hommage affectueux au cinéma d'épouvante des années 70 et 80. Trois ans plus tard, il renoue avec les mêmes ambitions modestes dans un huis-clos imposé par un vieil hôtel classieux auquel deux employés vont invoquer le fantôme d'une défunte suicidée ! Le Pitch: Deux gérants d'un hôtel prochainement clôturé s'intéressent de plus près aux phénomènes paranormaux en invoquant l'esprit d'un fantôme en guise d'ennui. Avec l'arrivée d'une ancienne actrice et d'un vieillard interlope, d'étranges évènements vont peu à peu se confirmer et devenir plus frénétiques.Ti West est un véritable amoureux du genre horrifique des années 70 et 80 tant il façonne avec parcimonie ce nouveau métrage largement influencé par les ambiances latentes et les angoisses diffuses. Après son formidable House of the Devil, le réalisateur renoue donc avec une histoire classique de maison hantée entièrement dédiée à l'effet de suggestion et du suspense sous-jacent émaillé d'inattendues pointes de cocasserie. Dès la mise en place des deux employés juvéniles, Ti West accorde une principale attention à nous familiariser auprès d'eux à travers leur complicité amicale des plus manifeste. Pat est un trentenaire solitaire occupant son temps à surfer sur le net, spécialement les pages web érigées sur l'occultisme (voirs aussi quelques sites pornos, faute d'un célibat de longue durée) quand la clientèle de son hôtel s'y fait rare. Son acolyte Claire demeurant une jeune fille un peu empotée attirée par les phénomènes paranormaux que Pat s'amuse à lui narrer en guise d'ennui. Ensemble, ils décident sans conviction d'invoquer le fantôme d'une défunte anciennement pendue dans la chambre 353 de l'hôtel. C'est le début d'une succession de futiles évènements intrigants avant que n'y culmine un revirement cinglant !
Ainsi, la complémentarité spontanée des deux comédiens accentuée de la maladresse de la jeune garçonne doit beaucoup à l'attrait sympathique d'un récit misant beaucoup sur leur complicité amiteuse à jouer les parapsychologues en herbe. Affublés d'une physionomie naturelle en "cool attitude", Ti West prend son temps à nous décrire leur relation amicale émaillée de futiles instants de tendresse (la confession de Pat à Claire sous emprise de l'alcool) avant de nous façonner sans esbroufe une traditionnelle histoire de fantôme constamment efficiente. Par vague de scénettes burlesques improvisées par notre héroïne puisque cumulant ses maladresses tributaires d'une peur panique, The Innkeepers réussit à provoquer l'amusement tout en nous faisant patienter pour les éventuelles apparitions surnaturelles. Une manière ludique et finaude à mieux nous prendre au piège de l'effroi légitimé lors de sa dernière partie échevelée. Au soin vétuste accordé à l'architecture de l'hôtel classique et à ses décors de lugubres corridors et de cave tamisée, le réalisateur nous entraîne en interne de ce huis-clos davantage anxiogène après qu'un dernier client eut préconisé d'investir la fameuse chambre 353. Soin du cadre alambiqué (parfois oblique) pour mettre en exergue des décors raffinés ou lugubres et score musical vrombissant sont octroyés pour parachever vers un climat de terreur en crescendo. Si bien qu'avec une économie de moyens, une bande son habilement distillée et une perspicacité à éluder le moindre effet choc inutilement explicite, The Innkeepers fait constamment appel à l'imagination du spectateur plutôt que de se laisser influencer par la surenchère en vogue. Quant aux fameuses apparitions fantomatiques, elles s'avèrent proprement terrifiantes de par leur aspect morbide et fétide découlant d'un effet de surprise alors que son point d'orgue cruel Spoil ! surprendra le public habitué aux happy-end salvateurs Fin du Spoil.
Hormis son épilogue perfectible où nous n'apprendrons rien sur le mystère de Madeline O'Malley (en appréciant sa dramaturgie imposée, mais la dernière image, vaine, ne surprend guère), le nouveau film de Ti West confirme tout le bien que l'on pensait de lui après l'excellent House of the Devil. De par la dextérité d'une réalisation assidue conçue à renouer avec les ambiances angoissantes allouées au pouvoir de suggestion, The Innkeepers amuse, effraie (tout du moins à 3/4 occasions) et captive sans ambages sous l'impulsion de protagonistes désirables qu'on aimerait côtoyer dans notre quotidienneté. Du cinéma d'épouvante artisanal en somme se prenant autant au sérieux qu'en dérision dans un cadre minimaliste pour autant esthétisant.
23.01.12. 179 v