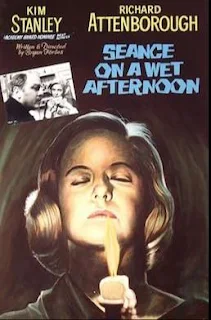(Crédit photo : image trouvée via Google, provenant du site senscritique. Utilisée ici à des fins non commerciales et illustratives).
Top 2025 franc-tireur.
"Parthenope - La vie comme une mer trop calme, ou chant funèbre pour les amours manqués".
Il est des expériences cinématographiques qui laissent bouche bée, sans qu’on saisisse vraiment ce à quoi l’on vient de prendre part - tant Paolo Sorrentino se refuse à livrer les clefs de lecture. Parthenope fait partie de ces œuvres rares, complexes, délicates, profondes et graciles que l’on contemple comme un rêve suspendu, soufflant le tiède et le froid.
Inscrit dans une mélancolie à la fois tendre, sensuelle et existentielle, ce film joue les ascenseurs émotionnels (attention : les ruptures de ton risquent d’en désarçonner plus d’un). Parthenope nous fait traverser 73 ans d’existence aux côtés d’une sirène charnelle qui ne parvient jamais à habiter sa propre vie. Alors que Naples (corruptible) l’entoure de désirs jusqu’à l’obsession, elle observe ce monde baroque - tour à tour cruel, chaleureux, désenchanté - avec une tendresse de plus en plus affectée, au fil de ses expériences amoureuses et de son éveil intellectuel.

Dans sa plénitude innée, la jeune actrice Celeste Dalla Porta irradie l'écran auprès de sa sensualité tranquille, sa sérénité rassurante, sa sensualité naturelle d'un calme (faussement) épanoui.
Transpirant la nonchalance d’un amour éperdu, au fil de rencontres parfois lunaires qui désarçonnent autant l’héroïne que le spectateur, ce mélo existentiel inconsolable, sublimé par ses chansons italiennes, nous écorche le cœur à vif. Sa sève philosophique, métaphysique suinte à travers Parthenope et ses proches les plus cérébraux jusqu'à nous perdre dans la déraison, l'interrogation, le bouleversement moral, la foi amoureuse que l'on ne peut maîtriser.
Et nous, spectateurs, quittons difficilement des yeux l’écran - comme elle, perdue dans ses pensées, dans la beauté de ses souvenirs, alors que s’annonce le générique - d’avoir vécu, deux heures dix-sept durant, une expérience émotive aussi trouble que bouleversante. Comme une fleur finalement fragile se rendant soudain compte qu’elle s’est fanée avec le temps.
Sa vie est une énigme, et se souvenir devient une forme d’art. Le film lui-même peine à la cerner, comme si elle était toujours ailleurs – au bord du réel, au bord d’elle-même.
"Sous les paupières de Parthenope".
Sensiblement envoûtant sans jamais rien pouvoir contrôler, Parthenope est un chef-d’œuvre lyrique, audacieux, provocateur et hétérodoxe que le réalisateur italien Paolo Sorrentino nous livre sans anesthésie, avec la maîtrise des sentiments les plus sobres et la pudeur étouffée d’une émotion sans emphase.
Mais attention aux déchirants adieux que suscite la fin : quitter Parthenope, c’est perdre une amie, une femme, une muse, une maîtresse - insaisissable et aimée - que l’on n’a pas su retenir, glissant à travers les doigts comme une mémoire qui s’efface.
Viva il cinema italiano 💖
Gratitude Jean-Marc Micciche pour l'influence involontaire.
*Bruno
-----------------------------------------------------------------
"Parthenope - Naître au monde sans y appartenir"
Elle naît de la mer comme une apparition. Parthenope, sirène napolitaine, femme sans ancrage, silhouette toujours en décalage avec le monde. Sorrentino ne la filme pas comme un personnage, mais comme une vibration : le souvenir d’un été, l’ombre d’un amour, le battement sourd d’un regret.
Il y a dans ce film une beauté hypnotique, comme si chaque plan retenait son souffle. Et pourtant, derrière les dorures, la mer bleue et les visages d’hommes éblouis, Parthenope raconte une solitude indicible – celle d’une femme qui traverse l’existence sans jamais y trouver de prise.
Son malaise est discret, mais profond. Il suinte dans les silences, dans les regards qu’elle ne soutient pas, dans ses gestes suspendus. Elle vit, oui – mais à la manière d’un fantôme bienveillant. Ni colère, ni cris. Juste l’impression persistante que la vie se déroule à côté d’elle.
Ses amours ? Des esquisses. Des élans retenus. Elle attire, fascine, mais ne s’abandonne jamais tout à fait. Comme si l’amour lui était interdit, ou trop fragile pour s’y laisser prendre. Un frère trop proche, un amant disparu, un enfant qu’elle n’a pas gardé… Chaque rencontre semble échouer sur le rivage d’un impossible.
Et lorsqu’elle vieillit, que les mots deviennent des outils, que l’intellect tente de contenir ce qui lui a échappé, il est déjà trop tard. Reste la mémoire. Mais même celle-ci semble fuyante, noyée dans une mélancolie douce.
Parthenope, c’est l’histoire d’une femme qui ne parvient jamais à habiter sa propre vie. Une femme belle jusqu’à l’irréel, que le monde regarde mais ne comprend pas. Et que le film lui-même peine à cerner, comme si elle était toujours ailleurs – au bord du réel, au bord d’elle-même.
C’est aussi un chant funèbre pour les amours manqués, les décisions non prises, les instants qu’on n’a pas su retenir. Un poème en forme de vague, lent, somptueux, troublant. Il ne faut pas attendre de ce film un récit, mais une sensation : celle d’avoir frôlé quelque chose d’immense et de vide à la fois.
*Aurélie.
Sortie salles France: 12 Mars 2025
Distribution: Celeste Dalla Porta, Daniele Rienzo, Dario Aita, Silvio Orlando, Gary Oldman