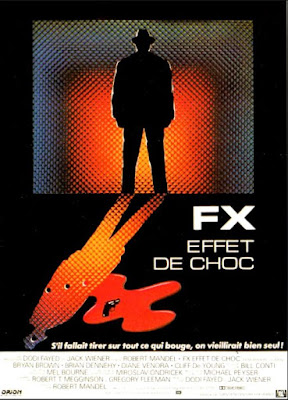Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com
"El Camino: A Breaking Bad Movie" de Vince Gilligan. 2019. U.S.A. 2h02. Avec Aaron Paul, Bryan Cranston, Charles Baker, Matt L. Jones, Jonathan Banks, Larry Hankin.
Diffusion mondiale Netflix: 11 Octobre 2019
FILMOGRAPHIE: Vince Gilligan est un scénariste, producteur et réalisateur américain, né le 10 février 1967 à Richmond. 2000-2002 : X-Files - Je souhaite (saison 7, épisode 21) et Irréfutable (saison 9, épisode 18). 2008-2013: Breaking Bad - Chute libre (saison 1, épisode 1) - Pleine Mesure (saison 3, épisode 13) - Échec (saison 4, épisode 12) – Mat (saison 4, épisode 13) - Revenir et Mourir (saison 5, épisode 16). 2015-2017 : Better Call Saul (4 épisodes). 2019: El Camino.
"La vie est ce que tu en fais"
Créateur de la notable série TV Breaking Bad, Vince Gilligan a décidé d'offrir à ses fans planétaires une adaptation ciné en bonne et due forme afin de clore une bonne fois pour toute les vicissitudes de Jesse Pinkman, ultime survivant recherché en l'occurrence par toutes les polices de l'état. Ainsi donc, à travers la simplicité de sa trame pour autant imprévisible afin de tenir en haleine le spectateur scrupuleux aux faits et gestes de Jesse traqué tous azimuts, Vince Gilligan exploite de main de maître un jeu de la survie aussi tendu qu'angoissant eu égard des moult rebondissements que notre anti-héros tentera de déjouer en faisant preuve d'esprit retors mais aussi de maladresse (à l'instar de sa houleuse transaction avec le vendeur d'aspirateur que campe au travers d'une posture impassible le vétéran Robert Foster au charisme sclérosé).
Magnifiquement réalisé, tant auprès des cadrages alambiqués, des effets de style épaulés d'une photo solaire que de ses influences westerniennes (avec un duel d'anthologie à couper le souffle !), El Camino rappelle entre autres dans notre inconscient le cinéma perfectionniste de Tarantino à travers ses dialogues ciselés (un régal permanent !) et ses confrontations masculines chargées de dérision, de perversité et de sournoiserie. D'une durée standard de 2h02, on aurait peut-être souhaité un métrage un peu plus quantitatif de 3h00 tant le temps s'étiole à la vitesse de l'éclair. Si bien que l'on surprend de quitter Jesse sur cette ultime image même si sa conclusion rationnelle ne déçoit aucunement. Ce qui prouve donc l'effet hypnotique qu'eurent si bien procurés sa charpente narrative (tant indécise) et les déplacements des personnages matois impliqués dans un enjeu pécuniaire en lieu et place de confort (pour les méchants) ou de survie (pour le destin précaire de Jesse). Au-delà du plaisir éprouvé à son imagerie stylisée et à ses péripéties instillées au compte-goutte avec un art consommé du suspense latent, El Camino est évidemment transcendé du jeu borderline d'Aaron Paul toujours aussi habité à travers ses expressions contradictoires où s'entrechoquent appréhension, espoir fébrile et détermination pugnace sans jamais se laisser distraire par l'invraisemblance du geste héroïque.
"Aller là où l'univers t'emmènes."
Tourné en format scope, El Camino demeure donc une excellente prolongation à l'éminente série Breaking Bad (à défaut d'y parfaire le chef-d'oeuvre auprès des plus gourmets), même si on aurait souhaité poursuivre un peu plus le périple de Jesse (avec 1 ou 2 rebondissements supplémentaires. Quand bien même Vince Gilligan est parvenu sans aucune prétention à boucler la boucle avec une indiscutable cohérence, tant en terme de cheminement narratif d'une remarquable fluidité que de psychologie des personnages (parmi 2/3 apparitions surprises impliquées dans une éthique existentielle !).
*Bruno
vendredi 11 octobre 2019
jeudi 10 octobre 2019
l'Esclave de Satan
Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com
"Satan's Slave" de Norman J. Warren. 1976. Angleterre. 1h29. Avec Michael Gough, Martin Potter, Candace Glendenning, Barbara Kellerman, Michael Craze.
Sortie salle France: 8 Février (ou 3 Mai) 1978 (Int - 18 ans). Angleterre: Décembre 76.
FILMOGRAPHIE: Norman J. Warren, né Norman John Warren le 25 Juin 1942 à Londres en Angleterre, est un réalisateur, producteur et scénariste anglais. 1967: Her Private Hell, 1968: Loving Feeling, 1976: l'Esclave de Satan, 1978: Le Zombie venu d'ailleurs, 1979: Outer Touch, la Terreur des Morts-vivants, 1981: Inseminoïd, 1984: Warbirds Air Display, 1985: Person to person, 1986: Gunpowder, 1987: Les Mutants de la St-Sylvestre, 1992: Meath School, 1993: Buzz.
Le pitch: à la suite de la mort de ses parents lors d'un accident de voiture, Catherine est recueillie par son oncle Alexandre ainsi que Stephen, le fils de celui-ci. En proie à d'horrible cauchemars durant ses nuits esseulées, elle se laisse amadouer par Stephen avant que la majordome Frances n'éprouve envers lui de violents signes de jalousie.
1er essai horrifique auprès de l'habile artisan british Norman J. Warren (Inseminoïd, Le Zombie venu d'ailleurs), l'Esclave de Satan transpire l'amour du genre aussi étique soit son intrigue probablement influencée par les films satanistes qui pullulaient lors des Seventies (Course contre l'Enfer, La Pluie du Diable). Ainsi, dans un format de série B symptomatique des budgets low-cost qu'il s'octroya durant sa carrière, Norman J. Warren accomplit le prodige de nous envoûter et de nous captiver de par la puissance des ces images gothiques d'une beauté sépulcrale ensorcelante. Ainsi, la psychologie prémâchée des personnages à beau laisser à désirer (notamment auprès de la posture subitement incohérente de Frances puisque délibérée à sauver l'héroïne pour un mobile inconnu alors qu'elle n'éprouvait que de la jalousie auprès de l'étrangère !) et l'intrigue, somme toute classique, céder à la trivialité, l'Esclave de Satan affiche un réalisme cauchemardesque prédominant eu égard de sa fulgurance visuelle et de la posture fragile de Catherine en proie à la magie noire et les forces du Mal. Tant auprès de ses hallucinations vécues de nuit ou en plein jour que des exactions insidieuses de son oncle délibéré à passer à l'acte lors d'un final dérangeant (twist sardonique à l'appui réfutant le happy-end !).
Warren illustrant donc avec une attention scrupuleuse des séances de messe noire adeptes du sacrifice humain avec un raffinement gothique rutilant. Quand bien même la forêt automnale environnant la vaste bâtisse s'alloue d'une atmosphère d'étrangeté aussi trouble que capiteuse. Au-delà du plaisir éprouvé auprès de ce climat tant atmosphérique, l'Esclave de Satan cède (comme de coutume chez son auteur) à une agréable complaisance lors de scènes gores aussi bien crues que malsaines (zooms grossiers à l'appui sur les chairs striées). Quand bien même les étreintes sexuelles et séances de nudité cèdent parfois au viol outrageant qu'effectue l'un de complices satanistes. On peut également, non sans une certaine indulgence, saluer la sobriété attachante de son casting méconnu (en dépit du vénérable Michael Gough en gourou démonial), aussi perfectibles soient leurs expressions autoritaires ou leurs sentiments de contrariété, et ce même si le manque d'intensité dramatique s'y fait ressentir si j'évoque l'épreuve endeuillée de Catherine lors de la première partie du film. Mais c'est principalement le jeu oh combien diaphane et dérangeant de Martin Potter (le fils d'Alexandre) qui frappe les esprits de par sa pâle présence à la fois insidieuse et équivoque, notamment auprès de ses rapports lubriques avec les femmes se clôturant dans un bain de sang.
Un film d'ambiance aux p'tits oignons disparu de nos écrans depuis des siècles de léthargie !
Magnétique, voir même ensorcelant, attachant et étonnamment captivant, notamment dans l'art de narrer son histoire viciée, l'Esclave de Satan a beau paraître mineur, parfois maladroit et prévisible, il n'en demeure pas moins bourré de charme et d'insolence de par son brio d'instaurer sans modération une ambiance cauchemardesque au sein du thème sataniste.
*Bruno
2èx
"Satan's Slave" de Norman J. Warren. 1976. Angleterre. 1h29. Avec Michael Gough, Martin Potter, Candace Glendenning, Barbara Kellerman, Michael Craze.
Sortie salle France: 8 Février (ou 3 Mai) 1978 (Int - 18 ans). Angleterre: Décembre 76.
FILMOGRAPHIE: Norman J. Warren, né Norman John Warren le 25 Juin 1942 à Londres en Angleterre, est un réalisateur, producteur et scénariste anglais. 1967: Her Private Hell, 1968: Loving Feeling, 1976: l'Esclave de Satan, 1978: Le Zombie venu d'ailleurs, 1979: Outer Touch, la Terreur des Morts-vivants, 1981: Inseminoïd, 1984: Warbirds Air Display, 1985: Person to person, 1986: Gunpowder, 1987: Les Mutants de la St-Sylvestre, 1992: Meath School, 1993: Buzz.
Le pitch: à la suite de la mort de ses parents lors d'un accident de voiture, Catherine est recueillie par son oncle Alexandre ainsi que Stephen, le fils de celui-ci. En proie à d'horrible cauchemars durant ses nuits esseulées, elle se laisse amadouer par Stephen avant que la majordome Frances n'éprouve envers lui de violents signes de jalousie.
1er essai horrifique auprès de l'habile artisan british Norman J. Warren (Inseminoïd, Le Zombie venu d'ailleurs), l'Esclave de Satan transpire l'amour du genre aussi étique soit son intrigue probablement influencée par les films satanistes qui pullulaient lors des Seventies (Course contre l'Enfer, La Pluie du Diable). Ainsi, dans un format de série B symptomatique des budgets low-cost qu'il s'octroya durant sa carrière, Norman J. Warren accomplit le prodige de nous envoûter et de nous captiver de par la puissance des ces images gothiques d'une beauté sépulcrale ensorcelante. Ainsi, la psychologie prémâchée des personnages à beau laisser à désirer (notamment auprès de la posture subitement incohérente de Frances puisque délibérée à sauver l'héroïne pour un mobile inconnu alors qu'elle n'éprouvait que de la jalousie auprès de l'étrangère !) et l'intrigue, somme toute classique, céder à la trivialité, l'Esclave de Satan affiche un réalisme cauchemardesque prédominant eu égard de sa fulgurance visuelle et de la posture fragile de Catherine en proie à la magie noire et les forces du Mal. Tant auprès de ses hallucinations vécues de nuit ou en plein jour que des exactions insidieuses de son oncle délibéré à passer à l'acte lors d'un final dérangeant (twist sardonique à l'appui réfutant le happy-end !).
Warren illustrant donc avec une attention scrupuleuse des séances de messe noire adeptes du sacrifice humain avec un raffinement gothique rutilant. Quand bien même la forêt automnale environnant la vaste bâtisse s'alloue d'une atmosphère d'étrangeté aussi trouble que capiteuse. Au-delà du plaisir éprouvé auprès de ce climat tant atmosphérique, l'Esclave de Satan cède (comme de coutume chez son auteur) à une agréable complaisance lors de scènes gores aussi bien crues que malsaines (zooms grossiers à l'appui sur les chairs striées). Quand bien même les étreintes sexuelles et séances de nudité cèdent parfois au viol outrageant qu'effectue l'un de complices satanistes. On peut également, non sans une certaine indulgence, saluer la sobriété attachante de son casting méconnu (en dépit du vénérable Michael Gough en gourou démonial), aussi perfectibles soient leurs expressions autoritaires ou leurs sentiments de contrariété, et ce même si le manque d'intensité dramatique s'y fait ressentir si j'évoque l'épreuve endeuillée de Catherine lors de la première partie du film. Mais c'est principalement le jeu oh combien diaphane et dérangeant de Martin Potter (le fils d'Alexandre) qui frappe les esprits de par sa pâle présence à la fois insidieuse et équivoque, notamment auprès de ses rapports lubriques avec les femmes se clôturant dans un bain de sang.
Un film d'ambiance aux p'tits oignons disparu de nos écrans depuis des siècles de léthargie !
Magnétique, voir même ensorcelant, attachant et étonnamment captivant, notamment dans l'art de narrer son histoire viciée, l'Esclave de Satan a beau paraître mineur, parfois maladroit et prévisible, il n'en demeure pas moins bourré de charme et d'insolence de par son brio d'instaurer sans modération une ambiance cauchemardesque au sein du thème sataniste.
*Bruno
2èx
mercredi 9 octobre 2019
House of sand and fog
Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com
de Vadim Perelman. 2003. U.S.A. 2h06. Avec Jennifer Connelly, Ben Kingsley, Ron Eldard, Frances Fisher, Kim Dickens, Shohreh Aghdashloo.
Sortie salles France: 13 Mai 2004 (uniquement au marché du Film du Festival de Cannes). U.S: 26 Décembre 2003.
FILMOGRAPHIE: Vadim Perelman est un réalisateur et producteur russo-américain né le 8 septembre 1963 à Kiev (Ukraine). 2003 : House of Sand and Fog. 2008 : La Vie devant ses yeux. 2016 : Yolki 5.
Drame psychologique mâtiné de mélo sous le pilier d'une partition envoûtante, House of sand and fog fut ignoré de nos salles chez nous en dépit de sa projection au marché du film du Festival de Cannes. Et donc j'imagine que les distributeurs ont probablement été effrayés par le nihilisme de son final effroyablement dépressif pour oser le faire connaître auprès du grand public. Car délibéré à châtier tous ces protagonistes au grand dam d'un enjeu matérialiste (expulsée de chez elle à la suite d'une erreur des impôts, Kathy tente de récupérer la demeure de son père face au refus drastique de son nouveau propriétaire d'origine iranienne), le réalisateur privilégie une intensité dramatique en crescendo afin d'ébranler le spectateur finalement déconcerté par tant d'aigreur et de pessimisme. Mais au-delà des effets de surprise de son final mélodramatique franchement discutable, car à mon sens plombé par sa sinistrose infructueuse, (pour ne pas dire illogique), House of sand and fog bénéficie d'une intrigue solide entièrement bâtie sur la confrontation psychologique entre une jeune solitaire en perdition et un père de famille pratiquant, déterminé à subvenir aux besoins de sa famille en tablant sur la plus-value de sa nouvelle bâtisse.
Au centre de ce duo houleux où chacun tente de défendre son bout de territoire avec acharnement et désespoir, un shérif épris d'affection pour Kathy jouera les redresseurs de tort avec une maladresse préjudiciable. Constamment captivant de par son intrigue charpentée et surtout porté à bout de bras par les compositions talentueuses de Jennifer Connely en ange déchu épuisée par la solitude et la déveine, de Ben Kingsley en époux aussi prévenant qu'abusif avide de combler sa famille, et de Ron Eldard en shérif vindicatif d'autant plus contrarié par sa double liaison conjugale, House of sand and fog plante son intrigue et ses personnages autour d'une mise en scène posée préconisant les huis-clos intimistes (ceux des 2 couples susnommés). Sa densité narrative émanant également de l'évolution de ces personnages anti-manichéens se démenant comme ils peuvent à défendre leur position avec autant d'autorité que de fragilité. Ainsi, compromis par leurs sentiments d'orgueil matérialiste et pécuniaires (aussi compréhensifs soient leur combat pour la justice puis celui de la réussite sociale et familiale), ces derniers vont peu à peu céder à leur valeur d'empathie en se prêtant mutuellement main forte depuis l'incidence de circonstances fortuites.
Sur ce point, là aussi House of sand and fog fait mouche si bien qu'il est impossible d'anticiper les évènements orageux, d'autant plus que le réalisateur élude l'outrance sentimentale (ou alors si peu) afin d'émouvoir le spectateur impliqué dans cet improbable enjeu matérialiste. Les comédiens, sobrement poignants, ne débordant jamais dans leur condition morale malmenée, tant et si bien que l'on s'attache à leurs blessures intimes sans oser prendre parti pour qui que ce soit dans leur conflit d'ego ou d'intérêt à la fois financier et familial (notamment auprès de l'héritage de Kathy afin d'honorer son père). D'où l'intensité sobrement ressentie auprès de ce drame psychologique nouant brillamment les profils sentencieux de ces protagonistes effleurant pour autant l'issue de résolution lors d'un moment propice de remise en question. Et ce avant que Vadim Perelman ne vienne tout foutre en l'air pour brutaliser/phagocyter ses protagonistes lors d'un final tragique dénué de rédemption et de logique selon mon jugement de valeur. Aussi limpide et bénéfique soit son manifeste contre le matérialisme et la prospérité financière ! Et c'est fichtrement dommage car House of sand and fog avait au préalable assez d'arguments fiables et solides pour satisfaire le spectateur auprès d'un happy-end autrement noble, censé et légitime.
*Bruno
de Vadim Perelman. 2003. U.S.A. 2h06. Avec Jennifer Connelly, Ben Kingsley, Ron Eldard, Frances Fisher, Kim Dickens, Shohreh Aghdashloo.
Sortie salles France: 13 Mai 2004 (uniquement au marché du Film du Festival de Cannes). U.S: 26 Décembre 2003.
FILMOGRAPHIE: Vadim Perelman est un réalisateur et producteur russo-américain né le 8 septembre 1963 à Kiev (Ukraine). 2003 : House of Sand and Fog. 2008 : La Vie devant ses yeux. 2016 : Yolki 5.
Drame psychologique mâtiné de mélo sous le pilier d'une partition envoûtante, House of sand and fog fut ignoré de nos salles chez nous en dépit de sa projection au marché du film du Festival de Cannes. Et donc j'imagine que les distributeurs ont probablement été effrayés par le nihilisme de son final effroyablement dépressif pour oser le faire connaître auprès du grand public. Car délibéré à châtier tous ces protagonistes au grand dam d'un enjeu matérialiste (expulsée de chez elle à la suite d'une erreur des impôts, Kathy tente de récupérer la demeure de son père face au refus drastique de son nouveau propriétaire d'origine iranienne), le réalisateur privilégie une intensité dramatique en crescendo afin d'ébranler le spectateur finalement déconcerté par tant d'aigreur et de pessimisme. Mais au-delà des effets de surprise de son final mélodramatique franchement discutable, car à mon sens plombé par sa sinistrose infructueuse, (pour ne pas dire illogique), House of sand and fog bénéficie d'une intrigue solide entièrement bâtie sur la confrontation psychologique entre une jeune solitaire en perdition et un père de famille pratiquant, déterminé à subvenir aux besoins de sa famille en tablant sur la plus-value de sa nouvelle bâtisse.
Au centre de ce duo houleux où chacun tente de défendre son bout de territoire avec acharnement et désespoir, un shérif épris d'affection pour Kathy jouera les redresseurs de tort avec une maladresse préjudiciable. Constamment captivant de par son intrigue charpentée et surtout porté à bout de bras par les compositions talentueuses de Jennifer Connely en ange déchu épuisée par la solitude et la déveine, de Ben Kingsley en époux aussi prévenant qu'abusif avide de combler sa famille, et de Ron Eldard en shérif vindicatif d'autant plus contrarié par sa double liaison conjugale, House of sand and fog plante son intrigue et ses personnages autour d'une mise en scène posée préconisant les huis-clos intimistes (ceux des 2 couples susnommés). Sa densité narrative émanant également de l'évolution de ces personnages anti-manichéens se démenant comme ils peuvent à défendre leur position avec autant d'autorité que de fragilité. Ainsi, compromis par leurs sentiments d'orgueil matérialiste et pécuniaires (aussi compréhensifs soient leur combat pour la justice puis celui de la réussite sociale et familiale), ces derniers vont peu à peu céder à leur valeur d'empathie en se prêtant mutuellement main forte depuis l'incidence de circonstances fortuites.
Sur ce point, là aussi House of sand and fog fait mouche si bien qu'il est impossible d'anticiper les évènements orageux, d'autant plus que le réalisateur élude l'outrance sentimentale (ou alors si peu) afin d'émouvoir le spectateur impliqué dans cet improbable enjeu matérialiste. Les comédiens, sobrement poignants, ne débordant jamais dans leur condition morale malmenée, tant et si bien que l'on s'attache à leurs blessures intimes sans oser prendre parti pour qui que ce soit dans leur conflit d'ego ou d'intérêt à la fois financier et familial (notamment auprès de l'héritage de Kathy afin d'honorer son père). D'où l'intensité sobrement ressentie auprès de ce drame psychologique nouant brillamment les profils sentencieux de ces protagonistes effleurant pour autant l'issue de résolution lors d'un moment propice de remise en question. Et ce avant que Vadim Perelman ne vienne tout foutre en l'air pour brutaliser/phagocyter ses protagonistes lors d'un final tragique dénué de rédemption et de logique selon mon jugement de valeur. Aussi limpide et bénéfique soit son manifeste contre le matérialisme et la prospérité financière ! Et c'est fichtrement dommage car House of sand and fog avait au préalable assez d'arguments fiables et solides pour satisfaire le spectateur auprès d'un happy-end autrement noble, censé et légitime.
*Bruno
mardi 8 octobre 2019
Au coeur de la nuit
Photo empruntée sur Google, appartenant au site Senscritique.com
"Dead of Night" de Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden et Robert Hamer. 1945. Angleterre. 1h44. Avec Mervyn Johns, Roland Culver, Mary Merrall, Anthony Baird, Robert Wyndham, Judy Kelly, Sally Ann Howes, Michael Allan, Googie Withers, Ralph Michael, Basil Radford, Naunton Wayne, Frederick Valk, Allan Jeayes, Michael Redgrave.
Sortie salles France: 8 Mai 1946
FILMOGRAPHIE: Alberto de Almeida Cavalcanti (Rio de Janeiro, 6 février 1897 - Paris, 23 août 19821), est un scénariste, réalisateur et producteur d'origine brésilienne. 1926 : Le Train sans yeux. 1926 : Rien que les heures. 1927 : En rade. 1927 : Yvette. 1930 : Dans une île perdue. 1930 : Les Vacances du diable. 1931 : À mi-chemin du ciel. 1932 : Le Truc du Brésilien. 1932 : En lisant le journal. 1933 : Le Mari garçon. 1933 : Coralie et compagnie. 1944 : Champagne Charlie. 1945 : Au cœur de la nuit. 1958 : Les Noces vénitiennes. 1971 : La Visite de la vieille dame, téléfilm.
Si Au coeur de la nuit fait office de jalon des années 40 au sein du moule omnibus et qu'il influença une ribambelle de cinéastes (la célèbre firme Amicus lors des années 60 et tous ces fleurons british incarnés avec classe, la série TV La 4è Dimension créée par Rod Serling, la série B méconnue La Poupée Diabolique de Lindsay Shonteff, la saga des Chucky, etc...), il s'avère néanmoins désuet à travers ses segments à la fois trop courts, timorés et finalement peu surprenants. Si bien que depuis de l'eau a coulé sous les ponts car d'autres modèles autrement plus créatifs et audacieux se sont réappropriés du concept avec beaucoup plus d'imagination, d'efficacité, de folie et de violence (on peut d'ailleurs citer Histoires d'outre-tombe, Frissons d'outre-tombe, Creepshow ou encore Trick or Treat en guise de parangons du genre). Pour autant, Au coeur de la Nuit vaut encore le détour à travers sa troisième histoire gentiment ludique, un brin fascinante (un miroir déformant la réalité auprès de son nouvel acquéreur poussera ce dernier à la folie criminelle), et surtout avec son ultime sketch proprement fascinant, j'ai nommé le Mannequin du Ventriloque (que Richard Attenborough poursuivra en format long quelques décennies plus tard avec son chef-d'oeuvre Magic endossé par le jeune et déjà talentueux Anthony Hopkins).
Car prenant pour thèmes le dédoublement de personnalité, la possessivité et la démence autour d'un enjeu professionnel suggérant la compétition d'un confrère, le Mannequin du ventriloque dégage un climat de folie irréel compromis par les sentiments fétides de domination perverse lorsqu'une poupée à l'éloquence sarcastique semble douée de vie sous l'impulsion de son maître à penser tirant ses ficelles vocales. Transi d'émoi, de contrariété et d'angoisse palpable à travers son visage humecté par l'alcool et ses yeux aussi exorbités que vaporeux, Michael Redgrave crève l'écran, provoque l'empathie, distille gêne et malaise auprès de sa condition torturée de se livrer à l'infernale soumission de sa création de porcelaine. A moins que toute cette mise en scène impayable découle de son esprit schizophrène de s'être adonné corps et âme à son don de ventriloque afin de contenter un large public intransigeant. Puissant, vertigineux, terrifiant et d'autant plus cruel quant à sa conclusion davantage sardonique, ce sketch glaçant n'a aujourd'hui rien perdu de son pouvoir de fascination sous l'impulsion d'une intensité dramatique escarpée eu égard de la tournure navrante des conséquences battis sur la jalousie, l'emprise de la folie et la peur de l'anonymat. Ainsi donc, rien que pour l'impact émotionnel qu'il suscite encore aujourd'hui sur notre conscience, Au coeur de la Nuit est à ne pas rater auprès de ce bouquet final littéralement anthologique, qui plus est renforcé d'une photo monochrome renforçant ainsi le vérisme de cette tragique confrontation entre un artiste et son double.
*Bruno
2èx
"Dead of Night" de Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden et Robert Hamer. 1945. Angleterre. 1h44. Avec Mervyn Johns, Roland Culver, Mary Merrall, Anthony Baird, Robert Wyndham, Judy Kelly, Sally Ann Howes, Michael Allan, Googie Withers, Ralph Michael, Basil Radford, Naunton Wayne, Frederick Valk, Allan Jeayes, Michael Redgrave.
Sortie salles France: 8 Mai 1946
FILMOGRAPHIE: Alberto de Almeida Cavalcanti (Rio de Janeiro, 6 février 1897 - Paris, 23 août 19821), est un scénariste, réalisateur et producteur d'origine brésilienne. 1926 : Le Train sans yeux. 1926 : Rien que les heures. 1927 : En rade. 1927 : Yvette. 1930 : Dans une île perdue. 1930 : Les Vacances du diable. 1931 : À mi-chemin du ciel. 1932 : Le Truc du Brésilien. 1932 : En lisant le journal. 1933 : Le Mari garçon. 1933 : Coralie et compagnie. 1944 : Champagne Charlie. 1945 : Au cœur de la nuit. 1958 : Les Noces vénitiennes. 1971 : La Visite de la vieille dame, téléfilm.
Si Au coeur de la nuit fait office de jalon des années 40 au sein du moule omnibus et qu'il influença une ribambelle de cinéastes (la célèbre firme Amicus lors des années 60 et tous ces fleurons british incarnés avec classe, la série TV La 4è Dimension créée par Rod Serling, la série B méconnue La Poupée Diabolique de Lindsay Shonteff, la saga des Chucky, etc...), il s'avère néanmoins désuet à travers ses segments à la fois trop courts, timorés et finalement peu surprenants. Si bien que depuis de l'eau a coulé sous les ponts car d'autres modèles autrement plus créatifs et audacieux se sont réappropriés du concept avec beaucoup plus d'imagination, d'efficacité, de folie et de violence (on peut d'ailleurs citer Histoires d'outre-tombe, Frissons d'outre-tombe, Creepshow ou encore Trick or Treat en guise de parangons du genre). Pour autant, Au coeur de la Nuit vaut encore le détour à travers sa troisième histoire gentiment ludique, un brin fascinante (un miroir déformant la réalité auprès de son nouvel acquéreur poussera ce dernier à la folie criminelle), et surtout avec son ultime sketch proprement fascinant, j'ai nommé le Mannequin du Ventriloque (que Richard Attenborough poursuivra en format long quelques décennies plus tard avec son chef-d'oeuvre Magic endossé par le jeune et déjà talentueux Anthony Hopkins).
Car prenant pour thèmes le dédoublement de personnalité, la possessivité et la démence autour d'un enjeu professionnel suggérant la compétition d'un confrère, le Mannequin du ventriloque dégage un climat de folie irréel compromis par les sentiments fétides de domination perverse lorsqu'une poupée à l'éloquence sarcastique semble douée de vie sous l'impulsion de son maître à penser tirant ses ficelles vocales. Transi d'émoi, de contrariété et d'angoisse palpable à travers son visage humecté par l'alcool et ses yeux aussi exorbités que vaporeux, Michael Redgrave crève l'écran, provoque l'empathie, distille gêne et malaise auprès de sa condition torturée de se livrer à l'infernale soumission de sa création de porcelaine. A moins que toute cette mise en scène impayable découle de son esprit schizophrène de s'être adonné corps et âme à son don de ventriloque afin de contenter un large public intransigeant. Puissant, vertigineux, terrifiant et d'autant plus cruel quant à sa conclusion davantage sardonique, ce sketch glaçant n'a aujourd'hui rien perdu de son pouvoir de fascination sous l'impulsion d'une intensité dramatique escarpée eu égard de la tournure navrante des conséquences battis sur la jalousie, l'emprise de la folie et la peur de l'anonymat. Ainsi donc, rien que pour l'impact émotionnel qu'il suscite encore aujourd'hui sur notre conscience, Au coeur de la Nuit est à ne pas rater auprès de ce bouquet final littéralement anthologique, qui plus est renforcé d'une photo monochrome renforçant ainsi le vérisme de cette tragique confrontation entre un artiste et son double.
*Bruno
2èx
lundi 7 octobre 2019
Le Jour de Gloire
Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com
de Jacques Besnard. 1976. France. 1h34. Avec Jean Lefebvre, Pierre Tornade, Darry Cowl, Robert Rollis, Pierre Doris, Corinne Lahaye, Jacques Marin, Chantal Nobel, Hans Verner.
Sortie salles France: 8 Décembre 1976
FILMOGRAPHIE: Jacques Besnard est un réalisateur, scénariste et producteur français né le 15 juillet 1929 au Petit-Quevilly (Seine-Maritime) et mort le 9 novembre 2013 à Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir). 1966 : Le Grand Restaurant. 1967 : Estouffade à la Caraïbe. 1967 : Le Fou du labo 4. 1972 : La Belle Affaire ou Les marginaux. 1974 : C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. 1975 : La situation est grave... mais pas désespérée. 1976 : Le Jour de gloire. 1976 : Et si tu n'en veux pas ou Joëlle et Pauline. 1978 : Général... nous voilà ! 1982 : Te marre pas ... c'est pour rire ! 1984 : Allo Béatrice (TV). 1985 : Hôtel de police (TV). 1988 : La Belle Anglaise (TV). 1990 : Le Retour d'Arsène Lupin (1 épisode). 1992 : Feu Adrien Muset (TV). 1994 : Avanti, téléfilm.
En dépit de ses trop rares occasions d'éclats de rire égayant une trame linéaire faiblarde (durant l'occupation, des villageois de la commune de Saint-Laurent sont contraints d'accueillir les Allemands à la suite de l'explosion terroriste de leur pont, quand bien même le facteur Grégoire tentera de solliciter l'aide des américains), Le Jour de Gloire bénéficie pour autant d'un rythme soutenu et d'un attachant casting (Jean Lefebvre, Pierre Tornade, Darry Cowl, Robert Rollis, Pierre Doris) pour trouver l'ensemble gentiment bonnard. A réserver toutefois à la génération 80 tant cette comédie franchouillarde surfant sur le filon de la Grande Vadrouille accuse le poids des années, alors qu'à l'époque elle cumula tout de même 1 991 801 entrées (12è au Box-Office).
*Bruno
2èx
de Jacques Besnard. 1976. France. 1h34. Avec Jean Lefebvre, Pierre Tornade, Darry Cowl, Robert Rollis, Pierre Doris, Corinne Lahaye, Jacques Marin, Chantal Nobel, Hans Verner.
Sortie salles France: 8 Décembre 1976
FILMOGRAPHIE: Jacques Besnard est un réalisateur, scénariste et producteur français né le 15 juillet 1929 au Petit-Quevilly (Seine-Maritime) et mort le 9 novembre 2013 à Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir). 1966 : Le Grand Restaurant. 1967 : Estouffade à la Caraïbe. 1967 : Le Fou du labo 4. 1972 : La Belle Affaire ou Les marginaux. 1974 : C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. 1975 : La situation est grave... mais pas désespérée. 1976 : Le Jour de gloire. 1976 : Et si tu n'en veux pas ou Joëlle et Pauline. 1978 : Général... nous voilà ! 1982 : Te marre pas ... c'est pour rire ! 1984 : Allo Béatrice (TV). 1985 : Hôtel de police (TV). 1988 : La Belle Anglaise (TV). 1990 : Le Retour d'Arsène Lupin (1 épisode). 1992 : Feu Adrien Muset (TV). 1994 : Avanti, téléfilm.
En dépit de ses trop rares occasions d'éclats de rire égayant une trame linéaire faiblarde (durant l'occupation, des villageois de la commune de Saint-Laurent sont contraints d'accueillir les Allemands à la suite de l'explosion terroriste de leur pont, quand bien même le facteur Grégoire tentera de solliciter l'aide des américains), Le Jour de Gloire bénéficie pour autant d'un rythme soutenu et d'un attachant casting (Jean Lefebvre, Pierre Tornade, Darry Cowl, Robert Rollis, Pierre Doris) pour trouver l'ensemble gentiment bonnard. A réserver toutefois à la génération 80 tant cette comédie franchouillarde surfant sur le filon de la Grande Vadrouille accuse le poids des années, alors qu'à l'époque elle cumula tout de même 1 991 801 entrées (12è au Box-Office).
*Bruno
2èx
vendredi 4 octobre 2019
Midsommar
Photo empruntée sur Google, appartenant au site Allocine.fr
de Ari Aster. 2019. U.S.A/Suède. 2h27. Avec Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Will Poulter, Julia Ragnarsson, Anna Åström.
Sortie salles France: 31 Juillet 2019 (Int - 12 ans avec avertissement)
FILMOGRAPHIE: Ari Aster est un réalisateur, acteur et scénariste américain. Hérédité est sa première réalisation. 2018: Hérédité. 2019: Midsommar.
Sortir de la projo d'un film aussi singulier que Midsommar et tenter de relater sur papier ses chaudes impressions relève d'une ardue gageure tant le second long du surdoué Ari Aster m'a laissé en état de choc, de stupeur, de perplexité, de doute, de fascination, d'irritation, de désorientation, de malaise indicible. Un peu, beaucoup sonné, secoué, désarmé, amer, transi de fatigue morale, de par son aura anxiogène davantage dépressive, Midsommar demeure une expérience hallucinogène autour des rites d'une communauté païenne en harmonie/alchimie avec la nature et le sacrifice humain. Car à partir d'un pitch prévisible au schéma somme toute classique (durant leur villégiature, une bande de jeunes joue les anthropologues au sein d'une communauté hippie avant d'y être séquestrés, quand bien même la jeune fille qui les accompagne se remet difficilement de la mort de ses parents), Ari Aster plante lentement son décorum pour nous offrir une vraie proposition horrifique comme on en déniche rarement au sein du paysage cinématographique. Si bien qu'à travers son parti-pris fraîchement documenté, ce dernier s'efforce de capter, saisir, manipuler nos sens et nos émotions sous l'impulsion d'une pléthore d'images féeriques en contradiction avec les véritables agissements de sa communauté hérétique. Tant et si bien que son atmosphère malsaine, sous-jacente dans un premier temps, nous effleure subtilement les pores du visage afin de mieux nous ébranler ensuite vers sa progressive descente aux enfers dénuée de concession (et donc de happy-end).
Autant donc avertir fissa les amateurs non initiés, Midsommar divisera et déconcertera à coup une partie du public peu habité à ce genre d'expérience à la fois radicale et difficile d'accès, même certains d'entre eux connaissent sur le bout des ongles le chef-d'oeuvre British de Robin Hardy, The Wicker Man auquel le film s'inspire sans JAMAIS le remaker ! (je tiens à le surligner). Ainsi donc, en opposant les visions chocs de certaines scènes sanglantes ou autrement violentes parmi la présence limpide d'une communauté familiale accueillant ses hôtes avec un flegme paisible, Midsommar imprime un tel réalisme à l'écran naturaliste qu'il incommode le spectateur partagé entre l'interrogation, l'inexpliqué, le non-sens, la perplexité. Sa structure narrative cheminant autour des faits et gestes indécis de la vulnérable Dani en plein deuil parental, et donc facilement influençable (mais aussi terriblement expressive dans son malaise interne !) pour se laisser voguer par cette communauté séculaire sous l'impulsion de drogues psychédéliques. Ari Aster jouant notamment à merveille avec la distorsion d'images qu'il manipule à sa guise tel un alchimiste de l'apocalypse afin de confronter le spectateur à une angoisse aussi bien cérébrale que viscérale, à l'instar d'un bad trip que l'on ne parvient pas à extraire de soi. Son climat florissant faussement tranquille ne cessant de nous titiller la curiosité avec une amertume davantage craintive. Si bien que plus l'intrigue fétide progresse, plus le danger se fera plus explicite à coup d'échanges de regards, de cris et de silence communément complices, et ce avant de nous commotionner avec une ultime représentation emphatique nous distillant des émotions bipolaires.
Cintré, incongru, primitif et dérangé alors que son climat solaire de douce sérénité festoie autour de sourires frétillants, entre chants communautaires et danses païennes, Midsommar n'a comme ultime ambition que de distiller un malaise tangible auprès de l'appréhension du spectateur immergé dans un cauchemar onirique d'une rigueur naturaliste, eu égard de l'emprise sectaire jouant la fraternité avec un terrifiant aplomb commun. Que l'on adhère ou que l'on rejette cette proposition horrifique venue d'ailleurs, Midsommar laisse dans une partie de notre encéphale une moisson d'images chocs sublimement mises en scène, notamment de par son souci du détail rituel opéré en toute tranquillité au sein d'un Eden démonial. A revoir d'urgence pour en saisir toute sa substance faisandée !
Pour public averti si bien qu'il faut y être pleinement préparé afin d'apprécier à sa juste valeur l'expérience.
*Bruno
de Ari Aster. 2019. U.S.A/Suède. 2h27. Avec Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Will Poulter, Julia Ragnarsson, Anna Åström.
Sortie salles France: 31 Juillet 2019 (Int - 12 ans avec avertissement)
FILMOGRAPHIE: Ari Aster est un réalisateur, acteur et scénariste américain. Hérédité est sa première réalisation. 2018: Hérédité. 2019: Midsommar.
Sortir de la projo d'un film aussi singulier que Midsommar et tenter de relater sur papier ses chaudes impressions relève d'une ardue gageure tant le second long du surdoué Ari Aster m'a laissé en état de choc, de stupeur, de perplexité, de doute, de fascination, d'irritation, de désorientation, de malaise indicible. Un peu, beaucoup sonné, secoué, désarmé, amer, transi de fatigue morale, de par son aura anxiogène davantage dépressive, Midsommar demeure une expérience hallucinogène autour des rites d'une communauté païenne en harmonie/alchimie avec la nature et le sacrifice humain. Car à partir d'un pitch prévisible au schéma somme toute classique (durant leur villégiature, une bande de jeunes joue les anthropologues au sein d'une communauté hippie avant d'y être séquestrés, quand bien même la jeune fille qui les accompagne se remet difficilement de la mort de ses parents), Ari Aster plante lentement son décorum pour nous offrir une vraie proposition horrifique comme on en déniche rarement au sein du paysage cinématographique. Si bien qu'à travers son parti-pris fraîchement documenté, ce dernier s'efforce de capter, saisir, manipuler nos sens et nos émotions sous l'impulsion d'une pléthore d'images féeriques en contradiction avec les véritables agissements de sa communauté hérétique. Tant et si bien que son atmosphère malsaine, sous-jacente dans un premier temps, nous effleure subtilement les pores du visage afin de mieux nous ébranler ensuite vers sa progressive descente aux enfers dénuée de concession (et donc de happy-end).
Autant donc avertir fissa les amateurs non initiés, Midsommar divisera et déconcertera à coup une partie du public peu habité à ce genre d'expérience à la fois radicale et difficile d'accès, même certains d'entre eux connaissent sur le bout des ongles le chef-d'oeuvre British de Robin Hardy, The Wicker Man auquel le film s'inspire sans JAMAIS le remaker ! (je tiens à le surligner). Ainsi donc, en opposant les visions chocs de certaines scènes sanglantes ou autrement violentes parmi la présence limpide d'une communauté familiale accueillant ses hôtes avec un flegme paisible, Midsommar imprime un tel réalisme à l'écran naturaliste qu'il incommode le spectateur partagé entre l'interrogation, l'inexpliqué, le non-sens, la perplexité. Sa structure narrative cheminant autour des faits et gestes indécis de la vulnérable Dani en plein deuil parental, et donc facilement influençable (mais aussi terriblement expressive dans son malaise interne !) pour se laisser voguer par cette communauté séculaire sous l'impulsion de drogues psychédéliques. Ari Aster jouant notamment à merveille avec la distorsion d'images qu'il manipule à sa guise tel un alchimiste de l'apocalypse afin de confronter le spectateur à une angoisse aussi bien cérébrale que viscérale, à l'instar d'un bad trip que l'on ne parvient pas à extraire de soi. Son climat florissant faussement tranquille ne cessant de nous titiller la curiosité avec une amertume davantage craintive. Si bien que plus l'intrigue fétide progresse, plus le danger se fera plus explicite à coup d'échanges de regards, de cris et de silence communément complices, et ce avant de nous commotionner avec une ultime représentation emphatique nous distillant des émotions bipolaires.
Cintré, incongru, primitif et dérangé alors que son climat solaire de douce sérénité festoie autour de sourires frétillants, entre chants communautaires et danses païennes, Midsommar n'a comme ultime ambition que de distiller un malaise tangible auprès de l'appréhension du spectateur immergé dans un cauchemar onirique d'une rigueur naturaliste, eu égard de l'emprise sectaire jouant la fraternité avec un terrifiant aplomb commun. Que l'on adhère ou que l'on rejette cette proposition horrifique venue d'ailleurs, Midsommar laisse dans une partie de notre encéphale une moisson d'images chocs sublimement mises en scène, notamment de par son souci du détail rituel opéré en toute tranquillité au sein d'un Eden démonial. A revoir d'urgence pour en saisir toute sa substance faisandée !
Pour public averti si bien qu'il faut y être pleinement préparé afin d'apprécier à sa juste valeur l'expérience.
*Bruno
jeudi 3 octobre 2019
La rose pourpre du Caire. César du Meilleur Film Etranger, 1986.
Photo empruntée sur Google, appartenant au site ekladata.com
"The Purple Rose of Cairo" de Woody Allen. 1985. U.S.A. 1h22. Avec Mia Farrow, Jeff Daniels,
Danny Aiello, Dianne Wiest, Van Johnson, Zoe Caldwell, John Wood.
Sortie salles France: 29 Mai 1985. U.S: 1er Mars 1985.
FILMO: Woody Allen est un réalisateur américain, scénariste, acteur et humoriste américain, né le 1er décembre 1935 à New York.
“Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout.”
Qui n'a jamais rêvé un jour rencontrer en chair et en os sa star préférée du cinéma ? Mieux encore, et soyons donc plus fous ! Qui n'a jamais fantasmé pénétrer à l'intérieur de son film attitré ? Chef-d'oeuvre de féerie, d'humour et de romance jusqu'à plus soif, la Rose pourpre du Caire exauce nos souhaits les plus saugrenus à travers la chimère de la pellicule que Woody Allen met en exergue avec un sens onirique inusité ! Tant et si bien que certaines séquences hallucinées (les protagonistes du métrage en noir et blanc s'adressant au public et vice-versa, l'acteur principal s'extirpant de son film pour s'en aller rejoindre sa plus grande fan confinée dans la salle, quand bien même un peu plus tard cette dernière pénétrera à son tour en interne de la fiction) font peut-être partis des plus belles anthologies vécues sur une toile. Truffé d'invention, de drôlerie, de lyrisme, mais aussi entrecoupé de cruauté (si je me réfère surtout à sa radicale conclusion - pourtant censée - risquant d'en décevoir ou déprimer plus d'un !), la Rose pourpre du Caire donne le vertige, nous euphorise les sens sous l'impulsion de situations, quiproquos et revirements constamment imprévisibles. Si bien que sous couvert d'une romcom traitée durant l'obscure période de la crise de 29, Woody Allen nous prône une déclaration d'amour au cinéma à travers le regard ingénu d'une spectatrice avide de romance, de rêve et d'évasion, faute de sa condition d'exclusion. Car souffre-douleur tributaire de sa terne existence eu égard des maltraitances et de l'indifférence de son époux abusif, Cecilia, serveuse de bar empotée noyée dans ses pensées, s'immerge après le taf dans la chimère de son film favori afin d'oublier sa lamentable solitude.
Irradiant l'écran de sa chétive présence filiforme, Mia Farrow nous ensorcelle d'émotions à travers l'intensité de son regard d'enfant si bien que son âme semble s'extraire de son enveloppe (factice) d'actrice. Un personnage malingre trop vulnérable car plein de fragilité, de timidité, de doute et d'angoisse de par sa frêle tentative de survivre, d'oser se faire une place dans une société draconienne livrée au chômage, au sexisme, à l'égoïsme, l'austérité et le machisme. Mais au-delà de sa puissante réflexion sur notre rapport (si) intime avec la fiction ainsi que le pouvoir et la magie du cinéma égratignant au terme la naïveté des spectateurs les plus influençables, La Rose Pourpre du Caire inonde l'écran de gags cocasses où le merveilleux, la poésie, l'enchantement et la tendresse s'y chevauchent afin de nous imprimer l'une des plus incroyables romance vues sur l'écran. Si bien qu'en guise de persuasion et de cerise sur le gâteau, je ne peux oublier de saluer l'interprétation (binaire) de Jeff Daniels en acteur explorateur habité par la fougue amoureuse auprès de sa plus fidèle fan. Là aussi, à travers son regard exaltant plein d'innocence, de fantaisie, de gentille maladresse et de tendresse, Woody Allen nous scande un magnifique portrait d'aventurier franc-tireur de par sa soif de goûter à la véritable existence en s'extirpant du métrage de carton pâte ! Et ce avant de nous ramener à la brutalité de la réalité auprès du véritable acteur l'ayant ainsi conçu. J'ai nommé Gil Shepherd, dandy rupin finalement insidieux quant à sa crainte grandissante de voir sa carrière sombrer dans la négligence et la faillite.
“Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie.”
Courez donc (re)voir La Rose pourpre du Caire et pleurez à jamais dans les bras de la mélancolique et douce rêveuse Cecilia. L'un des personnages les plus élégiaques, attendrissants et bouleversants vus sur un écran de cinéma au point d'y révéler Mia Farrow emblème de l'amour...
P.S: Pour l'anecdote subsidiaire, il s'agit du film préféré de Woody Allen.
*Bruno
2èx
Box Office France: 1 842 700 Entrées
Récompenses:
1985 : BAFTA du meilleur film et du meilleur scénario.
1985 : NYFCC Award du meilleur scénario.
1985 : Prix Léon Moussinac.
1986 : César du meilleur film étranger.
1986 : Bodil du meilleur film non européen.
1986 : BSFC Award du meilleur scénario.
1986 : Prix FIPRESCI du Festival de Cannes
1987 : Prix Mainichi du meilleur film en langue étrangère.
mardi 1 octobre 2019
Killer Klowns from outer space / Les Clowns tueurs venus d'ailleurs
Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com
"Killer Klowns from outer space" de Stephen Chiodo. 1988. U.S.A. 1h28. Avec Grant Cramer, Suzanne Snyder, John Allen Nelson, John Vernon, Michael Siegel.
Sortie salles U.S: 27 Mai 1988. France (uniquement en video): Mars 1991
FILMOGRAPHIE: Stephen Chiodo est un réalisateur, producteur, scénariste, acteur américain, né le 2 Mars 1954 dans le Bronx à New York, USA. 1988: Les clowns tueurs venus d'ailleurs.
Film culte s'il en est dans un format de série B bricolée, Killer klowns from outer space demeure à ce jour l'unique réalisation de Stephen Chiodo (épaulé de ses 2 frères en charge de scénariste et de producteur). Et on peut vraiment déplorer qu'il n'ait pas percé dans le genre horrifique tant ce dernier, jamais avare d'idées vrillées, nous livre un jeu de massacre aussi fun que débridé. Car à partir d'une intrigue linéaire exploitant une énième invasion extra-terrestre (symptomatique des années 50 !), Killer klowns from outer space joue la singularité des tartes à la crème et des numéros de prestidigitateurs que d'inquiétants clowns tuméfiés exercent contre une population rurale en proie à la stupeur et l'incompréhension. Ainsi, à travers leur volumineuse apparence volontiers grotesque et décalée, ces derniers provoquent autant la fascination qu'un sensible malaise à travers leurs exubérances sournoises de se gausser de leurs victimes sans une once de clémence ou de remord. Qui plus est renforcé d'un rictus diablotin avec leur large dentition démanchée et leur gros nez rouge masquant pour autant leur point faible (effet de surprise assuré, mais chut !).
Sardonique donc mais pour autant plaisamment cocasse et jamais malsain (le gore s'avère quasi absent de la pellicule !), Killer klowns... compte sur leurs exactions criminelles ininterrompues pour amuser le public venu à assister aux festivités d'un numéro de cirque du 3è type. A l'instar de ses amples décors de carton pâte tout droit sortis d'un dessin animé psychédélique, tant et si bien que les victimes dépaysées par ce dédale futuriste se laissent facilement bernées pour être ensevelies dans des cocons de barbe à papa en guise de garde-manger. D'autre part, de par sa formulation volontairement décomplexée, friponne et grotesque, il est étonnant de constater que les comédiens sobrement attachants ne sombrent jamais (ou si peu) dans le ridicule afin de créer un surprenant contraste et ainsi éviter la série Z de pacotille. Tant auprès de leur parcours de survie, de leur condition de chair à pâté ou du périple héroïque qu'un jeune couple redouble en s'efforçant d'avertir et de convaincre deux flics entêtés.
Complètement autre, doucement inquiétant et démentiel, notamment auprès de la disparité de ses décors festoyants, Killer Klowns from outer space demeure un régal d'originalité à travers sa pluralité de séquences-chocs en filiation avec nos souvenirs infantiles ! Tant et si bien que l'on se laisse immédiatement embarquer dans cette 4è dimension cartoonesque sous l'impulsion de clowns humanoïdes étonnamment tumultueux à travers leur magnétisme mutique !
*Bruno
3èx
01.10.19
28.03.03
"Killer Klowns from outer space" de Stephen Chiodo. 1988. U.S.A. 1h28. Avec Grant Cramer, Suzanne Snyder, John Allen Nelson, John Vernon, Michael Siegel.
Sortie salles U.S: 27 Mai 1988. France (uniquement en video): Mars 1991
FILMOGRAPHIE: Stephen Chiodo est un réalisateur, producteur, scénariste, acteur américain, né le 2 Mars 1954 dans le Bronx à New York, USA. 1988: Les clowns tueurs venus d'ailleurs.
Film culte s'il en est dans un format de série B bricolée, Killer klowns from outer space demeure à ce jour l'unique réalisation de Stephen Chiodo (épaulé de ses 2 frères en charge de scénariste et de producteur). Et on peut vraiment déplorer qu'il n'ait pas percé dans le genre horrifique tant ce dernier, jamais avare d'idées vrillées, nous livre un jeu de massacre aussi fun que débridé. Car à partir d'une intrigue linéaire exploitant une énième invasion extra-terrestre (symptomatique des années 50 !), Killer klowns from outer space joue la singularité des tartes à la crème et des numéros de prestidigitateurs que d'inquiétants clowns tuméfiés exercent contre une population rurale en proie à la stupeur et l'incompréhension. Ainsi, à travers leur volumineuse apparence volontiers grotesque et décalée, ces derniers provoquent autant la fascination qu'un sensible malaise à travers leurs exubérances sournoises de se gausser de leurs victimes sans une once de clémence ou de remord. Qui plus est renforcé d'un rictus diablotin avec leur large dentition démanchée et leur gros nez rouge masquant pour autant leur point faible (effet de surprise assuré, mais chut !).
Sardonique donc mais pour autant plaisamment cocasse et jamais malsain (le gore s'avère quasi absent de la pellicule !), Killer klowns... compte sur leurs exactions criminelles ininterrompues pour amuser le public venu à assister aux festivités d'un numéro de cirque du 3è type. A l'instar de ses amples décors de carton pâte tout droit sortis d'un dessin animé psychédélique, tant et si bien que les victimes dépaysées par ce dédale futuriste se laissent facilement bernées pour être ensevelies dans des cocons de barbe à papa en guise de garde-manger. D'autre part, de par sa formulation volontairement décomplexée, friponne et grotesque, il est étonnant de constater que les comédiens sobrement attachants ne sombrent jamais (ou si peu) dans le ridicule afin de créer un surprenant contraste et ainsi éviter la série Z de pacotille. Tant auprès de leur parcours de survie, de leur condition de chair à pâté ou du périple héroïque qu'un jeune couple redouble en s'efforçant d'avertir et de convaincre deux flics entêtés.
Complètement autre, doucement inquiétant et démentiel, notamment auprès de la disparité de ses décors festoyants, Killer Klowns from outer space demeure un régal d'originalité à travers sa pluralité de séquences-chocs en filiation avec nos souvenirs infantiles ! Tant et si bien que l'on se laisse immédiatement embarquer dans cette 4è dimension cartoonesque sous l'impulsion de clowns humanoïdes étonnamment tumultueux à travers leur magnétisme mutique !
*Bruno
3èx
01.10.19
28.03.03
lundi 30 septembre 2019
Nous irons tous au paradis
Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com
d'Yves Robert. 1977. France. 1h50. Avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Danièle Delorme, Marthe Villalonga, Jenny Arasse, Christophe Bourseiller, Josiane Balasko
Sortie salles France: 9 Novembre 1977
FILMOGRAPHIE: Yves Robert est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur français né le 19 juin 1920 à Saumur, décédé le 10 mai 2002 à Paris. 1954 : Les Hommes ne pensent qu'à ça (acteur, producteur). 1958 : Ni vu... Ni connu... 1959 : Signé Arsène Lupin. 1960 : La Famille Fenouillard. 1961 : La Guerre des boutons. 1963 : Bébert et l'Omnibus. 1964 : Les Copains. 1965 : Monnaie de singe. 1967 : Alexandre le bienheureux. 1969 : Clérambard. 1972 : Le Grand Blond avec une chaussure noire. 1973 : Salut l'artiste. 1974 : Le Retour du grand blond. 1976 : Un éléphant ça trompe énormément. 1977 : Nous irons tous au paradis. 1979 : Courage, fuyons. 1984 : Le Jumeau. 1990: La Gloire de mon père. 1990 : Le Château de ma mère. 1991 : Le Bal des casse-pieds. 1993 : Montparnasse-Pondichéry.
Même si moins drôle, originale et réussie que son modèle (notamment auprès de sa mise en scène plus prosaïque et de ses dialogues moins ciselés), Nous irons tous au paradis est une excellente comédie romantique menée tambour battant par nos 4 lurons emportés par l'ivresse de l'amour et les tourments du deuil. L'intrigue se focalisant sur la filature prolongée d'Etienne persuadé que sa femme le trompe avec un inconnu à veste à carreau, quand bien même Daniel et Simon auront également une relation sentimentale avec leur nouvelle compagne. Outre les présences toujours aussi attachantes et décomplexées de Jean Rochefort, Claude Brasseur et Victor Lanoux, Guy Bedos tire son épingle du jeu en fils à maman toujours aussi irrité par sa présence envahissante (Marthe Villalonga irrésistible en matrone caractérielle d'un franc-parler dévastateur !). Si bien que ce dernier parvient également à un moment fortuit à susciter une empathie lors d'une sobre séquence dramatique à contre-emploi avec la légèreté du récit. Ainsi donc, à travers les thèmes de la jalousie, du mensonge, de la félonie et de la possessivité, Yves Robert nous emballe une comédie enlevée où l'infidélité peut parfois remédier à la routine comme le prouve le duo équivoque Etienne / Marthe. En guise de bonus subsidiaire, on reconnaîtra lors de 2 apparitions l'actrice Josiane Balasko à son plus jeune âge ainsi que les présences aussi furtives de Daniel Gélin et de Jean-Pierre Castaldi (irrésistible en mastard redresseur de tort).
*Bruno
3èx
d'Yves Robert. 1977. France. 1h50. Avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Danièle Delorme, Marthe Villalonga, Jenny Arasse, Christophe Bourseiller, Josiane Balasko
Sortie salles France: 9 Novembre 1977
FILMOGRAPHIE: Yves Robert est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur français né le 19 juin 1920 à Saumur, décédé le 10 mai 2002 à Paris. 1954 : Les Hommes ne pensent qu'à ça (acteur, producteur). 1958 : Ni vu... Ni connu... 1959 : Signé Arsène Lupin. 1960 : La Famille Fenouillard. 1961 : La Guerre des boutons. 1963 : Bébert et l'Omnibus. 1964 : Les Copains. 1965 : Monnaie de singe. 1967 : Alexandre le bienheureux. 1969 : Clérambard. 1972 : Le Grand Blond avec une chaussure noire. 1973 : Salut l'artiste. 1974 : Le Retour du grand blond. 1976 : Un éléphant ça trompe énormément. 1977 : Nous irons tous au paradis. 1979 : Courage, fuyons. 1984 : Le Jumeau. 1990: La Gloire de mon père. 1990 : Le Château de ma mère. 1991 : Le Bal des casse-pieds. 1993 : Montparnasse-Pondichéry.
Même si moins drôle, originale et réussie que son modèle (notamment auprès de sa mise en scène plus prosaïque et de ses dialogues moins ciselés), Nous irons tous au paradis est une excellente comédie romantique menée tambour battant par nos 4 lurons emportés par l'ivresse de l'amour et les tourments du deuil. L'intrigue se focalisant sur la filature prolongée d'Etienne persuadé que sa femme le trompe avec un inconnu à veste à carreau, quand bien même Daniel et Simon auront également une relation sentimentale avec leur nouvelle compagne. Outre les présences toujours aussi attachantes et décomplexées de Jean Rochefort, Claude Brasseur et Victor Lanoux, Guy Bedos tire son épingle du jeu en fils à maman toujours aussi irrité par sa présence envahissante (Marthe Villalonga irrésistible en matrone caractérielle d'un franc-parler dévastateur !). Si bien que ce dernier parvient également à un moment fortuit à susciter une empathie lors d'une sobre séquence dramatique à contre-emploi avec la légèreté du récit. Ainsi donc, à travers les thèmes de la jalousie, du mensonge, de la félonie et de la possessivité, Yves Robert nous emballe une comédie enlevée où l'infidélité peut parfois remédier à la routine comme le prouve le duo équivoque Etienne / Marthe. En guise de bonus subsidiaire, on reconnaîtra lors de 2 apparitions l'actrice Josiane Balasko à son plus jeune âge ainsi que les présences aussi furtives de Daniel Gélin et de Jean-Pierre Castaldi (irrésistible en mastard redresseur de tort).
*Bruno
3èx
vendredi 27 septembre 2019
Soleil Vert. Grand Prix, Avoriaz 74.
"Soylent Green" de Richard Fleischer. 1973. U.S.A. 1h37. Avec Charlton Heston, Leigh Taylor-Young, Chuck Connors, Joseph Cotten, Brock Peters, Paula Kelly, Edward G. Robinson.
Sortie en Salles: 19 Avril 1973 (New-York), 9 Mai 1973 (Etats-Unis), 26 Juin 1974 (France)
FILMOGRAPHIE: Richard Fleischer est un réalisateur américain né le 8 décembre 1916 à Brooklyn, et décédé le 25 Mars 2006 de causes naturelles. 1952: l'Enigme du Chicago Express, 1954: 20 000 lieux sous les mers, 1955: les Inconnus dans la ville, 1958: les Vikings, 1962: Barabbas, 1966: le Voyage Fantastique, 1967: l'Extravagant Dr Dolittle, 1968: l'Etrangleur de Boston, 1970: Tora, tora, tora, 1971: l'Etrangleur de Rillington Place, 1972: Terreur Aveugle, les Flics ne dorment pas la nuit, 1973: Soleil Vert, 1974: Mr Majestyk, Du sang dans la Poussière, 1975: Mandingo, 1979: Ashanti, 1983: Amityville 3D, 1984: Conan le destructeur, 1985: Kalidor, la légende du talisman, 1989: Call from Space.

Le pitch: En 2022, l'avenir du monde est sur la corde raide. Surpopulation, pollution, réchauffement climatique, famines et crise du logement mènent le sort de l'humanité vers une ultime alternative. Le soleil vert, bleu ou rouge constitue une tablette alimentaire synthétique à base de plancton afin de subvenir à la famine. Mais derrière ce nouveau produit de consommation prolifique se cache un terrifiant secret. C'est ce que découvrira au péril de sa vie un flic obtus enquêtant sur la mort d'un des directeurs de la production.
Un an après son fiévreux polar Les Flics ne dorment pas la nuit, Richard Fleischer se tourne vers la science-fiction pour nous illustrer l'une des plus épeurantes prophéties du devenir de notre humanité en s'inspirant d'un roman de Harry Harrison. Ovationné l'année suivante par son Grand Prix au Festival d'Avoriaz, Soleil Vert demeure en l'occurrence plus que jamais d'actualité à travers ses thèmes politiques, écolos, sociaux sous l'impulsion d'une intensité émotionnelle inconsolable. Car en visionnaire défaitiste, Richard Fleischer, nous met irrémédiablement dans l'ambiance fuligineuse dès son générique illustrant, via images d'archives, le développement industriel des mégalopoles à l'orée du 20è siècle, et ce jusqu'au 21è siècle de notre civilisation contemporaine. Un flot de séquences blafardes, insalubres, claustros débouchant sur la surpopulation et la pollution en progressive dégénérescence.

Qui plus est, cette entrée en matière prophétique est exacerbée d'une partition mélancolique de Fred Myrow afin d'appuyer l'échec de nos dirigeants plus préoccupés par leurs transactions lucratives au grand dam de la sauvegarde de notre planète. Ainsi, parmi ces images de foule humaine implantée dans des cités insalubres, Soleil Vert démarre fort pour agripper promptement la gorge le spectateur de par son esthétisme cauchemardesque rigoureusement cru car sensoriel. Et donc, à travers une enquête criminelle latente, l'intrigue met en avant la quotidienneté routinière de Robert Thorn. Un flic émérite co-habitant avec le vieux retraité, Sol Roth, avant qu'il ne découvre l'incroyable machination d'un lâche assassinat. Avec sobriété pour la confection de décors high-tech extériorisant un New-york aussi diaphane que suffocant (éclairé d'un filtre vert plus vrai que nature), Richard Fleischer réussit avec une grande efficacité à provoquer l'effroi, aussi bien moral que viscéral. De par l'émotion de scènes intimistes, on peut d'ailleurs citer la séquence édifiante auquel Sol propose à son jeune acolyte de savourer à nouveau les plaisirs culinaires d'antan que ce dernier n'eut jamais connu. A savoir déguster une feuille de salade fraîche, quelques tomates juteuses, une tranche de boeuf ou encore une pomme rouge fruitée ! Par leur complicité doucement cocasse d'un jeu de regards désireux, nos deux compères réussissent à provoquer une émotion aigre davantage poignante quant à la réminiscence de cette époque révolue où l'alimentation faisait office de denrée fertile. Il faut d'ailleurs savoir qu'à l'origine cette séquence emblématique terriblement dérangeante fut improvisée en plein tournage à la demande de Charlton Heston et Edward G. Roberson.

Ainsi, plus engagé que jamais pour la préservation de notre environnement, Richard Fleisher frappe de plein fouet à travers son cri d'alarme écolo dépeignant un avenir caniculaire à la fois despotique et phallocrate, où la femme, battue, dépréciée, est comparable à un "objet de location" ou à un "mobilier". Où les pauvres démunis, affamés et sans emploi sont parqués les uns sur les autres dans des églises ou sur les escaliers d'immeuble afin de tenter de trouver le sommeil. Quant aux forces de l'ordre drastiques, elles sont contraintes d'amasser les ouvriers contestataires à l'aide de pelleteuses pour les entasser dans leur camion benne comme du bétail. Quand bien même les riches notables égocentriques ont droit à une existence beaucoup plus prospère et épanouie dans leurs luxueux pavillons climatisés où coulent à flot eau chaude, bouffe, alcool, sexe et produits sanitaires. Quant à la faune et la flore, leur existence n'est plus qu'un lointain souvenir radoté par nos ancêtres, ceux-ci étant davantage tentés par le suicide en guise d'exutoire ou d'une désillusion trop lourde à porter. A ce sujet, lorsque Sol parvient à découvrir l'horrible constituant des tablettes vertes, Richard Fleischer nous exacerbe l'une des séquences d'euthanasie les plus bouleversantes du cinéma ! Car étendu sur un lit spécialement conçu pour l'accueillir, le vieil homme contemplera durant plus de vingt minutes les merveilles écolos de notre civilisation séculaire durant la projo d'un film sur écran géant. Une séquence bouleversante, d'une infinie tristesse élégiaque, tant auprès du regard éploré de la victime que de la beauté flamboyante de cet Eden révolu, renforcé d'une symphonie classique de Beethoven, Tchaïkovsky et Peer Gynt. Hymne fastueux à la nature et à la vie animale, ce tableau onirique bouleverse autant le spectateur, partagé (comme Sol) entre le spleen, l'émerveillement et la sinistrose, de par sa puissance d'évocation féerique.
A travers ses moyens modestes pour autant extrêmement convaincants afin d'authentifier une dystopie aussi horrifiante que morbide, Richard Fleischer privilégie la caractérisation humaine de ses personnages épris de mélancolie et de mal-être existentiel à observer la situation chaotique d'une civilisation aussi inculte (les livres se font toujours plus rares) que déshumanisée asservit par le fascisme. Effroyablement crédible pour dépeindre un climat de fin du monde irrespirable car gangrené par la pollution, la solitude, la pauvreté, l'esclavagisme, la phallocratie et l'immoralité (Spoil ! au point de ne plus respecter nos ancêtres puisqu'on y traite de cannibalisme industriel en lieu et place d'élevage animal Fin du Spoiler), ce chef-d'oeuvre avant-gardiste s'avère d'autant plus l'un des plus nihilistes réquisitoires contre les corporations agroalimentaires de nos sociétés modernes. Eprouvant, malsain, dur et sans échappatoire, Soleil Vert nous laisse en état de choc et de marasme, à l'instar d'une commotion cérébrale.
*Bruno
27.09.19. 4èx
26.07.11. 240 v
Récompenses: Grand Prix au Festival d'Avoriaz en 1974.
Prix du meilleur film de science-fiction (Saturn Award), lors de l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur en 1975.
Note: Edward G. Robinson, qui venait de clôturer son 101ème dernier film, mourut en janvier 1973 (rongé par un cancer) peu après la fin du tournage, alors que Soleil vert n'était pas encore présenté au public.
jeudi 26 septembre 2019
Un Eléphant ça trompe énormément
Photo empruntée sur Google, appartenant au site Imdb.com
de Yves Robert. 1976. France. 1h48. Avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Danièle Delorme, Anny Duperey, Martine Sarcey, Marthe Villalonga.
Sortie salles France: 22 Septembre 1976
FILMOGRAPHIE: Yves Robert est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur français né le 19 juin 1920 à Saumur, décédé le 10 mai 2002 à Paris. 1954 : Les Hommes ne pensent qu'à ça (acteur, producteur). 1958 : Ni vu... Ni connu... 1959 : Signé Arsène Lupin. 1960 : La Famille Fenouillard. 1961 : La Guerre des boutons. 1963 : Bébert et l'Omnibus. 1964 : Les Copains. 1965 : Monnaie de singe. 1967 : Alexandre le bienheureux. 1969 : Clérambard. 1972 : Le Grand Blond avec une chaussure noire. 1973 : Salut l'artiste. 1974 : Le Retour du grand blond. 1976 : Un éléphant ça trompe énormément. 1977 : Nous irons tous au paradis. 1979 : Courage, fuyons. 1984 : Le Jumeau. 1990: La Gloire de mon père. 1990 : Le Château de ma mère. 1991 : Le Bal des casse-pieds. 1993 : Montparnasse-Pondichéry.
"Chaque minute de ce film porte en lui sa recette miracle, un visage de jeunesse éternelle."
7è au Box-office chez nous avec 2 925 868 entrées, Un Eléphant ça trompe énormément n'a point à rougir de son succès public (mais aussi critique), de par le talent fripon d'Yves Robert imprimant sa personnalité avec une liberté de ton galvanisante. Car prenant pour thèmes l'amitié, la jalousie, l'adultère et le désir (irrépressible) de séduire du point de vue d'une crise de quarantaine, Un Eléphant ça trompe énormément enchaîne bévues, stratégies et quiproquos déjantés à travers une moisson de sketchs souvent irrésistibles de drôlerie ou de cocasserie. Tant auprès de la gestuelle des acteurs s'en donnant à coeur joie dans leur mimique facétieuse que de l'originalité des circonstances de drague parmi l'inoubliable clin d'oeil à 7 ans de Réflexion. Car sans jamais juger ses personnages pour autant hypocrites, égoïstes, machistes, menteurs et séducteurs, principalement si je me réfère au personnage central de Jean Rocheford en dandy (volontairement) vaniteux car promptement amoureux d'une inconnue en robe rouge, Yves Robert dresse les portraits plein de vitalité et de désordre d'une bande de copains plongés dans la cacophonie à entretenir ou à se réapproprier l'amour à travers leurs postures indécises, rêveuses, décomplexées.
Comédie romantique donc baignant dans une subtile tendresse au rythme de la partition gracile de Vladimir Cosma et de dialogues pleins de poésie, Un Eléphant ça trompe énormément parvient à traverser le temps de par sa singularité (et son audace) à traiter des relations amoureuses homme / femme avec une ambiguïté parfois poignante (telle ce plan inoubliable où l'épouse d'Etienne, non dupe de la tromperie, aperçoit avec stupeur son mari à la TV, entre expressions dichotomiques de rires et de larmes !). Bien entendu, outre l'étonnante fantaisie qui se dégage de la plupart des séquences les plus mémorables et impromptues (le final confiné du haut d'un immeuble s'avère littéralement anthologique dans sa circonstance d'adultère aussi grotesque que débridée !); on peut évidemment applaudir la spontanéité commune de Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor Lanoux jouant la bande de potes indéfectibles avec une fringance aussi bien touchante qu'exaltée.
Beaucoup plus intelligent et fin qu'il n'y parait de prime abord, Un Eléphant ça trompe énormément évolue de manière fréquemment surprenante en se raillant avec gentillesse, tendresse, respect de l'amour conjugal au gré des portraits perplexes de quadras en proie à l'aventure et au doute dans leur désir de plaire. Ainsi, à travers ses portraits caustiques plein d'humanisme et de contradiction morale y émanent un moment de cinéma inoxydable qu'Yves Robert est parvenu à transcender, tant auprès de l'impulsion de son casting 4 étoiles que de sa personnalité affranchie.
*Bruno
3èx
de Yves Robert. 1976. France. 1h48. Avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Danièle Delorme, Anny Duperey, Martine Sarcey, Marthe Villalonga.
Sortie salles France: 22 Septembre 1976
FILMOGRAPHIE: Yves Robert est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur français né le 19 juin 1920 à Saumur, décédé le 10 mai 2002 à Paris. 1954 : Les Hommes ne pensent qu'à ça (acteur, producteur). 1958 : Ni vu... Ni connu... 1959 : Signé Arsène Lupin. 1960 : La Famille Fenouillard. 1961 : La Guerre des boutons. 1963 : Bébert et l'Omnibus. 1964 : Les Copains. 1965 : Monnaie de singe. 1967 : Alexandre le bienheureux. 1969 : Clérambard. 1972 : Le Grand Blond avec une chaussure noire. 1973 : Salut l'artiste. 1974 : Le Retour du grand blond. 1976 : Un éléphant ça trompe énormément. 1977 : Nous irons tous au paradis. 1979 : Courage, fuyons. 1984 : Le Jumeau. 1990: La Gloire de mon père. 1990 : Le Château de ma mère. 1991 : Le Bal des casse-pieds. 1993 : Montparnasse-Pondichéry.
"Chaque minute de ce film porte en lui sa recette miracle, un visage de jeunesse éternelle."
7è au Box-office chez nous avec 2 925 868 entrées, Un Eléphant ça trompe énormément n'a point à rougir de son succès public (mais aussi critique), de par le talent fripon d'Yves Robert imprimant sa personnalité avec une liberté de ton galvanisante. Car prenant pour thèmes l'amitié, la jalousie, l'adultère et le désir (irrépressible) de séduire du point de vue d'une crise de quarantaine, Un Eléphant ça trompe énormément enchaîne bévues, stratégies et quiproquos déjantés à travers une moisson de sketchs souvent irrésistibles de drôlerie ou de cocasserie. Tant auprès de la gestuelle des acteurs s'en donnant à coeur joie dans leur mimique facétieuse que de l'originalité des circonstances de drague parmi l'inoubliable clin d'oeil à 7 ans de Réflexion. Car sans jamais juger ses personnages pour autant hypocrites, égoïstes, machistes, menteurs et séducteurs, principalement si je me réfère au personnage central de Jean Rocheford en dandy (volontairement) vaniteux car promptement amoureux d'une inconnue en robe rouge, Yves Robert dresse les portraits plein de vitalité et de désordre d'une bande de copains plongés dans la cacophonie à entretenir ou à se réapproprier l'amour à travers leurs postures indécises, rêveuses, décomplexées.
Comédie romantique donc baignant dans une subtile tendresse au rythme de la partition gracile de Vladimir Cosma et de dialogues pleins de poésie, Un Eléphant ça trompe énormément parvient à traverser le temps de par sa singularité (et son audace) à traiter des relations amoureuses homme / femme avec une ambiguïté parfois poignante (telle ce plan inoubliable où l'épouse d'Etienne, non dupe de la tromperie, aperçoit avec stupeur son mari à la TV, entre expressions dichotomiques de rires et de larmes !). Bien entendu, outre l'étonnante fantaisie qui se dégage de la plupart des séquences les plus mémorables et impromptues (le final confiné du haut d'un immeuble s'avère littéralement anthologique dans sa circonstance d'adultère aussi grotesque que débridée !); on peut évidemment applaudir la spontanéité commune de Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor Lanoux jouant la bande de potes indéfectibles avec une fringance aussi bien touchante qu'exaltée.
Beaucoup plus intelligent et fin qu'il n'y parait de prime abord, Un Eléphant ça trompe énormément évolue de manière fréquemment surprenante en se raillant avec gentillesse, tendresse, respect de l'amour conjugal au gré des portraits perplexes de quadras en proie à l'aventure et au doute dans leur désir de plaire. Ainsi, à travers ses portraits caustiques plein d'humanisme et de contradiction morale y émanent un moment de cinéma inoxydable qu'Yves Robert est parvenu à transcender, tant auprès de l'impulsion de son casting 4 étoiles que de sa personnalité affranchie.
*Bruno
3èx
mercredi 25 septembre 2019
Crawl
Photo empruntée sur Google, appartenant au site Allocine.fr
d'Alexandre Aja. 2019. U.S.A. 1h27. Avec Kaya Scodelario, Tina Pribicevic, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner.
Sortie salles France: 24 Juillet 2019
FILMOGRAPHIE: Alexandre Aja (Alexandre Jouan-Arcady) est un réalisateur, producteur, scénariste, dialoguiste et acteur, né le 7 Août 1978 à Paris. 1999: Furia. 2003: Haute Tension. 2006: La Colline a des yeux. 2008: Mirrors. 2010: Piranha 3D. 2013: Horns. 2016: La Neuvième Vie de Louis Drax. 2019: Crawl.
Sorti en salles durant l'été, période à point nommé afin d'accueillir en bonne et due forme ce drive-in movie, Crawl transpire le spectacle du samedi soir avec une générosité et une sincérité forçant le respect. Car autour d'un concept de survie aquatique, l'intrigue simpliste a beau exploiter certaines grosses ficelles (la fille, experte en natation, usera donc de ses talents de nageuse émérite pour dépasser ses limites en affrontant les alligators), clichés (le toutou débonnaire au sort inévitablement fructueux - et perso, je ne m'en plains aucunement !-) et invraisemblances (les diverses mutilations que notre duo héroïque encaisse avec une résilience trop stoïque pour être honnête), Crawl nous agrippe à la gorge de par son réalisme éprouvant renforcé d'effets numériques aussi bluffants qu'irréprochables. Tant auprès des reptiles mastards plus vrais que nature dans leur mobilité véloce et leur férocité tranchée, que de l'ouragan diluvien qu'Alexandre Aja exploite en mode catastrophe avec une intensité vertigineuse. Bref, on y croit dur comme fer à ce que l'on assiste à l'écran !
Tant et si bien que son climat tempétueux demeure aussi hostile, ombrageux et fascinant que les alligators sur le qui-vive à surveiller leurs proies planquées dans la pénombre d'une cave. Ainsi, à travers sa scénographie résolument atmosphérique (tant en extérieur naturel - sublimement éclairé afin de contraster les nuages grisonnants - qu'en interne domestique), Aja nous immerge dans une descente aux enfers (celle de la cave puis les pièces du domicile familial) auquel un père et sa fille y ont malencontreusement trouvé refuge. Exploitant brillamment la gestion de l'espace à travers un cadre exigu à la fois anxiogène et étouffant (la cave dans un 1er temps), Aja relance efficacement l'action homérique à travers la disparité de ses décors opaques humectés par la montée des eaux, puis ceux décharnés quant au dernier acte situé en interne d'une bâtisse réduite en lambeaux. Sans se laisser influencer par la facilité des mises à morts gratuites et outrancières (façon Vendredi 13), Aja s'avère pour autant intelligemment généreux et impitoyable lorsqu'il s'agit de chorégraphier des séquences chocs redoutablement percutantes. Si bien que le spectateur calfeutré au siège s'avère aussi fasciné qu'épeuré à craindre les nouvelles éventuelles apparitions des alligators sournois prêts à alpaguer leurs victimes (de second plan) souvent démunies.
Un hommage affectueux digne d'une prod des années 80.
B movie horrifique mené de main de maître par un amoureux du genre Alexandre Aja réinvente donc le film de croco dans sa faculté innée de donner chair autant à ses lézards géants qu'à ses personnages auquel les comédiens, non familiers du public, s'avèrent sobrement convaincants dans leurs expressions d'appréhension, de vaillance et de cohésion (l'intrigue évoluant notamment vers une réconciliation parentale). Oscillant suspense tendu autour de frénétiques estocades non exemptes d'intensité dramatique, Crawl se décline en divertissement décoiffant en dépit de facilités rapidement occultées grâce à l'éminent savoir-faire de l'auteur.
*Bruno
d'Alexandre Aja. 2019. U.S.A. 1h27. Avec Kaya Scodelario, Tina Pribicevic, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner.
Sortie salles France: 24 Juillet 2019
FILMOGRAPHIE: Alexandre Aja (Alexandre Jouan-Arcady) est un réalisateur, producteur, scénariste, dialoguiste et acteur, né le 7 Août 1978 à Paris. 1999: Furia. 2003: Haute Tension. 2006: La Colline a des yeux. 2008: Mirrors. 2010: Piranha 3D. 2013: Horns. 2016: La Neuvième Vie de Louis Drax. 2019: Crawl.
Sorti en salles durant l'été, période à point nommé afin d'accueillir en bonne et due forme ce drive-in movie, Crawl transpire le spectacle du samedi soir avec une générosité et une sincérité forçant le respect. Car autour d'un concept de survie aquatique, l'intrigue simpliste a beau exploiter certaines grosses ficelles (la fille, experte en natation, usera donc de ses talents de nageuse émérite pour dépasser ses limites en affrontant les alligators), clichés (le toutou débonnaire au sort inévitablement fructueux - et perso, je ne m'en plains aucunement !-) et invraisemblances (les diverses mutilations que notre duo héroïque encaisse avec une résilience trop stoïque pour être honnête), Crawl nous agrippe à la gorge de par son réalisme éprouvant renforcé d'effets numériques aussi bluffants qu'irréprochables. Tant auprès des reptiles mastards plus vrais que nature dans leur mobilité véloce et leur férocité tranchée, que de l'ouragan diluvien qu'Alexandre Aja exploite en mode catastrophe avec une intensité vertigineuse. Bref, on y croit dur comme fer à ce que l'on assiste à l'écran !
Tant et si bien que son climat tempétueux demeure aussi hostile, ombrageux et fascinant que les alligators sur le qui-vive à surveiller leurs proies planquées dans la pénombre d'une cave. Ainsi, à travers sa scénographie résolument atmosphérique (tant en extérieur naturel - sublimement éclairé afin de contraster les nuages grisonnants - qu'en interne domestique), Aja nous immerge dans une descente aux enfers (celle de la cave puis les pièces du domicile familial) auquel un père et sa fille y ont malencontreusement trouvé refuge. Exploitant brillamment la gestion de l'espace à travers un cadre exigu à la fois anxiogène et étouffant (la cave dans un 1er temps), Aja relance efficacement l'action homérique à travers la disparité de ses décors opaques humectés par la montée des eaux, puis ceux décharnés quant au dernier acte situé en interne d'une bâtisse réduite en lambeaux. Sans se laisser influencer par la facilité des mises à morts gratuites et outrancières (façon Vendredi 13), Aja s'avère pour autant intelligemment généreux et impitoyable lorsqu'il s'agit de chorégraphier des séquences chocs redoutablement percutantes. Si bien que le spectateur calfeutré au siège s'avère aussi fasciné qu'épeuré à craindre les nouvelles éventuelles apparitions des alligators sournois prêts à alpaguer leurs victimes (de second plan) souvent démunies.
B movie horrifique mené de main de maître par un amoureux du genre Alexandre Aja réinvente donc le film de croco dans sa faculté innée de donner chair autant à ses lézards géants qu'à ses personnages auquel les comédiens, non familiers du public, s'avèrent sobrement convaincants dans leurs expressions d'appréhension, de vaillance et de cohésion (l'intrigue évoluant notamment vers une réconciliation parentale). Oscillant suspense tendu autour de frénétiques estocades non exemptes d'intensité dramatique, Crawl se décline en divertissement décoiffant en dépit de facilités rapidement occultées grâce à l'éminent savoir-faire de l'auteur.
*Bruno
mardi 24 septembre 2019
FX, Effets de Choc
Photo empruntée sur Google, appartenant au site orion-pictures.fandom.com
de Robert Mandel. 1986. U.S.A. 1h48. Avec Bryan Brown, Brian Dennehy, Cliff De Young, Mason Adams, Diane Venora, Jerry Orbach
Sortie salles France: 13 Août 1986
FILMOGRAPHIE: Robert Mandel est un réalisateur et producteur américain né en Californie. 1981 : Nights at O'Rear's. 1983 : Independence Day. 1983 : Andrea's Story: A Hitchhiking Tragedy (TV). 1984 : Welcome Home, Jellybean (TV). 1986 : F/X, effets de choc (F/X). 1986 : Touch and Go. 1987 : Big Shots. 1989 : Pas de répit sur planète Terre (série télévisée). 1989 : Témoin à tuer (TV). 1991 : La Maison hantée (TV). 1992 : La Différence. 1995 : Kansas (TV). 1996 : Special Report: Journey to Mars (TV). 1996 : The Substitute. 1997 : The Practice : Bobby Donnell et Associés (série télévisée). 2000 : Sans laisser de trace (Thin Air) (TV). 2001 : WW3 (TV). 2001 : Hysteria: The Def Leppard Story (TV). 2002 : A Season on the Brink (TV). 2002 : La Vie secrète de Zoé (TV). 2005 : Prison Break (série télévisée).
Série B ludique tirant parti de son concept aussi original que couillu (Tyler, expert en effets-spéciaux, accepte de feindre la mort d'un mafieux avant de se retrouver impliqué dans une machination), FX Effet de choc s'avère plutôt haletant dans sa moisson de péripéties spectaculaires, à l'instar d'une course poursuite automobile en centre urbain ou encore de la traque infernale que le héros endure au grand dam de victimes collatérales. Car sous le modèle connu du survival puis de l'auto-justice qui s'ensuit auprès de cette victime bouc émissaire, Fx Effet de choc assure le spectacle du samedi soir de par la posture retorse de celui-ci à parfaire le simulacre afin de compromettre une corruption policière. Pour ce faire, fort de son charisme fraîchement à la fois avenant et guilleret, et de sa force d'expression pugnace (notamment lors d'un corps à corps teigneux avec un tueur au sein de son appartement), Bryan Brown imprime une insolence payante en technicien passé maître dans l'art de duper ses ennemis parmi l'artillerie de gadgets novateurs. En lieutenant discrédité par sa hiérarchie policière, Brian Dennehy lui partage la vedette avec une force tranquille assez sereine à travers son investigation singulière culminant vers une filature fructueuse, notamment si je me réfère à l'audace de son épilogue gentiment amoral.
Sans être exceptionnel, et en dépit du côté parfois désuet des gadgets que le héros amorce avec une assurance davantage gouailleuse, Fx Effet de choc se décline en divertissement bonnard sous l'impulsion d'une action éclectique et d'attachants personnages jouant le jeu de la survie avec un héroïsme palpitant. D'ailleurs le film se soldera par un certain succès d'estime si bien qu'une séquelle (moins efficace) verra le jour en 1991 sous la houlette de Richard Franklin, quand bien même une série TV dérivée du diptyque durera deux saisons 5 ans plus tard.
*Bruno
2èx
Anecdote subsidiaire: FX est produit par Dodi Al-Fayed connu pour sa relation avec Lady Di avec qui il trouva la mort lors d'un accident de voiture le 31 août 1997 à Paris
de Robert Mandel. 1986. U.S.A. 1h48. Avec Bryan Brown, Brian Dennehy, Cliff De Young, Mason Adams, Diane Venora, Jerry Orbach
Sortie salles France: 13 Août 1986
FILMOGRAPHIE: Robert Mandel est un réalisateur et producteur américain né en Californie. 1981 : Nights at O'Rear's. 1983 : Independence Day. 1983 : Andrea's Story: A Hitchhiking Tragedy (TV). 1984 : Welcome Home, Jellybean (TV). 1986 : F/X, effets de choc (F/X). 1986 : Touch and Go. 1987 : Big Shots. 1989 : Pas de répit sur planète Terre (série télévisée). 1989 : Témoin à tuer (TV). 1991 : La Maison hantée (TV). 1992 : La Différence. 1995 : Kansas (TV). 1996 : Special Report: Journey to Mars (TV). 1996 : The Substitute. 1997 : The Practice : Bobby Donnell et Associés (série télévisée). 2000 : Sans laisser de trace (Thin Air) (TV). 2001 : WW3 (TV). 2001 : Hysteria: The Def Leppard Story (TV). 2002 : A Season on the Brink (TV). 2002 : La Vie secrète de Zoé (TV). 2005 : Prison Break (série télévisée).
Série B ludique tirant parti de son concept aussi original que couillu (Tyler, expert en effets-spéciaux, accepte de feindre la mort d'un mafieux avant de se retrouver impliqué dans une machination), FX Effet de choc s'avère plutôt haletant dans sa moisson de péripéties spectaculaires, à l'instar d'une course poursuite automobile en centre urbain ou encore de la traque infernale que le héros endure au grand dam de victimes collatérales. Car sous le modèle connu du survival puis de l'auto-justice qui s'ensuit auprès de cette victime bouc émissaire, Fx Effet de choc assure le spectacle du samedi soir de par la posture retorse de celui-ci à parfaire le simulacre afin de compromettre une corruption policière. Pour ce faire, fort de son charisme fraîchement à la fois avenant et guilleret, et de sa force d'expression pugnace (notamment lors d'un corps à corps teigneux avec un tueur au sein de son appartement), Bryan Brown imprime une insolence payante en technicien passé maître dans l'art de duper ses ennemis parmi l'artillerie de gadgets novateurs. En lieutenant discrédité par sa hiérarchie policière, Brian Dennehy lui partage la vedette avec une force tranquille assez sereine à travers son investigation singulière culminant vers une filature fructueuse, notamment si je me réfère à l'audace de son épilogue gentiment amoral.
Sans être exceptionnel, et en dépit du côté parfois désuet des gadgets que le héros amorce avec une assurance davantage gouailleuse, Fx Effet de choc se décline en divertissement bonnard sous l'impulsion d'une action éclectique et d'attachants personnages jouant le jeu de la survie avec un héroïsme palpitant. D'ailleurs le film se soldera par un certain succès d'estime si bien qu'une séquelle (moins efficace) verra le jour en 1991 sous la houlette de Richard Franklin, quand bien même une série TV dérivée du diptyque durera deux saisons 5 ans plus tard.
*Bruno
2èx
Anecdote subsidiaire: FX est produit par Dodi Al-Fayed connu pour sa relation avec Lady Di avec qui il trouva la mort lors d'un accident de voiture le 31 août 1997 à Paris
Inscription à :
Articles (Atom)