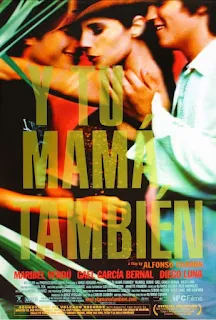jeudi 10 juillet 2025
The Quiet Girl de Colm Bairéad. 2022. Irlande. 1h34.
mercredi 9 juillet 2025
Et... ta mère aussi! (Y tu mamá también) de Alfonso Cuarón. 2001. Mexique. 1h46.
mardi 8 juillet 2025
Else de Thibault Emin. 2025. France. 1h43.
"Else, la métamorphose comme dernière étreinte".
What the fuck ???!!!
Et dire que cet ovni, aussi discret que discrédité (pas un seul trophée à Gérardmer, alors que l’anecdotique A Violent Nature récolta le Grand Prix !), est de souche française…
Et pourtant, il s’agit d’un premier long inspiré d’un court-métrage que Thibault Emin a mis des années à faire éclore.
À l’arrivée : une expérience singulière, vue nulle part ailleurs, à travers son concept de "métamorphisme" - terme géologique désignant une transformation physique minérale - que le réalisateur transpose à l’écran avec une créativité sans limites. Et ce, malgré un budget étriqué et un décor réduit à un huis clos domestique, bientôt transfiguré en espace organique, mouvant, sans repère spatial.
Croyez-moi : le spectacle, fascinatoire, demeure aussi vertigineux que malaisant, en s’émerveillant de l’onirisme d’une scénographie charnelle à la beauté irréelle et insoupçonnée.
D’un point de vue technique, impossible de ne pas penser au duo surdoué Hélène Cattet / Bruno Forzani, notamment dans la première demi-heure, où les effets de caméra - cadrages alambiqués, jeux optiques, mouvements habités - captivent l’œil. Pendant ce temps, on s’attache lentement à ce couple d’amants : l’un, réservé, l’autre, excentrique, presque perchée. Bonjour l'ambiance indicible où l'on avance pas à pas parmi eux.
D’une liberté de ton déroutante par ses ruptures émotionnelles, Else demeure un bad trip organique à la poésie sensuelle rare, traversé de visions cauchemardesques - claustros, troubles, charnelles, insécures.
Et si, au premier visionnage, on reste stupéfait, saisi, presque victime de ce choc visuel en perpétuelle mutation (même la couleur vire au noir et blanc, lors d’une régénération corporelle d’une puissance folle), on se dit très vite qu’il faudra y replonger. Urgemment. Car sous ce délire incongru affleure un conte métaphysique, où la thématique du deuil et de son acceptation devient le sésame d’un ailleurs - étrange, mais apaisé.
D’une puissance visuelle hallucinée, Else est une proposition fantastique radicale, auteurisante, qui ne plaira pas à tous - mais qui ravira les amateurs (éclairés) de spectacle viscéral autre, où l’émotion, trouble, charnelle, désespérée, nous happe irrémédiablement dans un vertige d’impuissance.
Bruno — cinéphile du cœur noir.
vendredi 4 juillet 2025
Blood Feast de Herschell Gordon Lewis. 1963. U.S.A. 1h07.
mercredi 2 juillet 2025
A bicyclette ! de Mathias Mlekuz. 2025. France. 1h29.
Retraçant le road trip d’un père en compagnie de son chien et de son meilleur ami, de l’Atlantique jusqu’à la mer Noire, afin de rendre hommage au suicide de son fils Youri après un voyage à vélo, À bicyclette ! nous cueille par la main là où on ne l’attend pas.
Mais il faut préciser qu’il s’agit moins d’une fiction que d’un documentaire où la majorité des séquences sont improvisées - les figurants et seconds rôles, d’un naturel bouleversant, croisent nos héros avec une vérité désarmante tout au long du périple.
Mathias Mlekuz (né dans ma ville de Lens), également réalisateur, incarne son propre rôle de père endeuillé, tandis que Philippe Rebbot, ami de longue date dans la vraie vie, joue le sien. Leur complicité ne relève pas du jeu ni de la mise en scène : elle vibre d’une amitié ancienne, sincère, palpable. Cette authenticité brute donne au récit sa chair, son souffle, son émotion.
Véritable hymne à la vie porté par un road movie débordant d’énergie, de tendresse, d’humour et de liberté, À bicyclette ! est un bonheur à l’état pur, derrière lequel se cache une quête de rédemption intime, nous imposant à notre tour une remise en question - celle du sens de nos trajectoires, de la place qu’on laisse au doute, à la douleur, à l’amour. Réflexion autant spirituelle que métaphysique, le film fait preuve d’une pudeur rare : dès que l’émotion menace de déborder, la caméra se dérobe, passe à une autre scène, comme pour mieux préserver la sincérité, la beauté, la dignité du geste. Ce parti-pris de discrétion devient un acte de bienveillance.
Formellement splendide, baigné de paysages naturalistes qui nous émeuvent autant qu’ils nous élèvent, le film est un petit miracle de cinéma sous ses atours de visite touristique. À la croisée de l’improvisation, du vécu, d’une fiction à peine esquissée, il nous emporte dans un vertige aussi bouleversant que cathartique. Et l’on comprend, en refermant ce chapitre de route, que chaque mort - brutale ou silencieuse - peut nous apprendre à grandir, à marcher autrement, à aimer mieux, à honorer, à chérir, à transmettre.
Festival du film francophone d'Angoulême 2024, en compétition officielle :
Valois de la mise en scène pour Mathias Mlekuz
Valois du public pour Mathias Mlekuz
Valois de la musique de film pour Pascal Lengagne
Festival 2 Cinéma 2 Valenciennes 2024 : section « Compétition fictions »:
Prix du public
Prix d'interprétation masculine pour Philippe Rebbot
mardi 1 juillet 2025
Substitution – Bring Her Back de Danny et Michael Philippou. 2025. Australie. 1h44.
Mais ici, changement de registre. Abandonnant le ton ludique, les Philippou adoptent un parti pris radical. Ils nous arrachent violemment à notre zone de confort, avec un électrochoc aussi digne, révulsif et malaisant que les enseignes traumatiques Martyrs, Eden Lake, Wolf Creek, voire L’Exorciste, auquel il prête une certaine filiation, toutes proportions gardées. Dès le prologue, des images d’archives (in)dignes d’Ogrish nous agressent sauvagement les mirettes. Et les exactions insalubres qui suivent font preuve d'un tel réalisme documenté qu'on croirait avoir affaire à un snuff… je n’en dirai pas plus. Des séquences nauséeuses, extrêmes, imprimées dans la rétine bien au-delà du générique.
En abordant avec intelligence, audace et sensibilité un traumatisme maternel, en sondant les conséquences de la maltraitance et la violence intériorisée chez celui qui l’a subie, les Philippou nous projettent tête baissée dans une descente aux enfers sans issue. Dénué de fioritures, ancré dans un réalisme de plus en plus incommodant, Bring Her Back va jusqu’au bout du malaise, sans détour, sans filtre. D’autant plus dérangeant qu’il met en lumière de jeunes adolescents livrés à la plus implacable torture, mentale et corporelle. Avec une utilisation judicieuse de regards pathologiquement tuméfiés qui contraste avec l'aura rubigineuse qui s'instille en leur cocon familial. Je m'adresse surtout à l'actrice Sora Wong (âgée de 14 ans au moment du tournage) , malvoyante dans la vie, née avec des malformations congénitales qui altèrent sa vision. Aveugle de l’œil gauche, sa vision de l’œil droit est d'autant plus réduite.
Et parce qu’ils prennent leur temps - distillant un suspense latent, à la fois mystérieux, inquiétant, déjà déstabilisant - les Philippou maîtrisent l’art de l’étau. On suffoque dans cette épreuve de force insidieuse, où se noue un jeu de manipulation morale entre une thérapeute, un garçon muet, un frère, et sa sœur aveugle.
On est ici face à une horreur premier degré, frontale, électrisante. L’absence d’humour glace le sang. Certaines séquences de châtiment sont si atroces qu’on se surprend à détourner les yeux. Bring Her Back joue dans la cour des grands, renouant avec une horreur fétide, licencieuse, rapace, vénéneuse - attisant sans relâche notre curiosité quant à des enjeux humains à la lueur d’espoir quasi inexistante.
On sort de la salle le regard hagard, vidé, lessivé. L’intensité dramatique est telle qu’on pressentait dès les premières minutes que ce jeu de confrontations psychologiques, aussi sournois que déloyal, ne pouvait que s’achever dans la plus animale des violences.
Impeccablement interprété - notamment dans les rôles juvéniles, candides, rebelles et meurtris - et transcendé par le jeu perfide de l’électrisante Sally Hawkins en thérapeute de l’effroi le plus aliénant, Bring Her Back nous cloue au siège. Il nous tétanise de désarroi face à cette lente agonie, cette horreur démoniale, trop extrême pour qu’on puisse s’en distraire. Alors que l'émotion rédemptrice de dernier ressort, cette douleur en héritage, finit par nous provoquer une empathie bouleversée face à l’amour en cendres.
Il tache, il lacère, il hante : sitôt vu, il s’imprime dans la rétine et vous ne l’oublierez jamais.
A condition de s'accrocher et de le prioriser au public averti (il sera chez nous interdit aux - 16 ans, avec Avertissement).
Laissez bronzer les Cadavres de Hélène Cattet et Bruno Forzani. 2017. France/Belgique. 1h32.
"Orgie solaire et plomb brûlant".
La mise en scène ? Un trip sensoriel, ultra stylisé, chaque plan suinte la perfection maniériste. Cattet et Forzani taillent l’espace, le son, le temps, comme on cisèle une idole païenne. Gros plans fétichistes, zooms assassins, éclats de métal et de chair, ralentis suspendus dans le néant. Le montage éclaté, halluciné, fait tournoyer les points de vue : on revit les mêmes scènes à travers d’autres regards, d'autres pulsions, toujours rythmées par l’heure affichée à l’écran, comme une montre piégée à la nitro.
Les acteurs ? Des gueules, des vraies, burinées, rugueuses, qu’on ne croise plus à l’écran. Ils n’interprètent pas, ils transpirent, ils brûlent. La violence, elle, n’est jamais gratuite, elle est rituelle, organique, sensorielle, féérique presque. Les corps s’aiment, se haïssent, se soumettent. Une femme qui urine sur la tête d’un homme, le viol par des balles de calibre, une autre fouettée, gorge ouverte, sous une pluie de champagne : jamais pornographique, jamais vulgaire. Onirique, dérangeant, d’une beauté toxique exotique.
Et puis viennent les fusillades, comme des ballets de feu et de mort. Du jamais-vu. Les chorégraphies explosent, entre Goldfinger et Fulci, entre Morricone et le rugissement du silence. Chaque tir est une note, chaque cri une pulsation. Le film devient opéra de mitraille sous des partitions transalpines que l'on s'entête par coeur.
C’est un cauchemar érotique en plein jour. Un rêve lucide baigné de sang, de poussière, de cendre (les corps se consument sous les flammes) et de soleil. Un pur orgasme cinématographique de souche française, une fois n'est pas coutume.
lundi 30 juin 2025
Dune: 2è partie / Dune: Part Two de Dennis Villeneuve. 2024. U.S.A/Canada. 2h46 (2h38).
The Love Witch de Anna Biller. 2016. U.S.A. 2h00.
Another Earth de Mike Cahill. 2011. U.S.A. 1h32.
vendredi 27 juin 2025
Dune, première partie de Dennis Villeneuve. 2021. U.S.A/Canada. 2h35.
jeudi 26 juin 2025
Parthenope de Paolo Sorrentino. 2024. France/Italie. 2h17.
"Parthenope - La vie comme une mer trop calme, ou chant funèbre pour les amours manqués".
Il est des expériences cinématographiques qui laissent bouche bée, sans qu’on saisisse vraiment ce à quoi l’on vient de prendre part - tant Paolo Sorrentino se refuse à livrer les clefs de lecture. Parthenope fait partie de ces œuvres rares, complexes, délicates, profondes et graciles que l’on contemple comme un rêve suspendu, soufflant le tiède et le froid.
Inscrit dans une mélancolie à la fois tendre, sensuelle et existentielle, ce film joue les ascenseurs émotionnels (attention : les ruptures de ton risquent d’en désarçonner plus d’un). Parthenope nous fait traverser 73 ans d’existence aux côtés d’une sirène charnelle qui ne parvient jamais à habiter sa propre vie. Alors que Naples (corruptible) l’entoure de désirs jusqu’à l’obsession, elle observe ce monde baroque - tour à tour cruel, chaleureux, désenchanté - avec une tendresse de plus en plus affectée, au fil de ses expériences amoureuses et de son éveil intellectuel.
Dans sa plénitude innée, la jeune actrice Celeste Dalla Porta irradie l'écran auprès de sa sensualité tranquille, sa sérénité rassurante, sa sensualité naturelle d'un calme (faussement) épanoui.
Transpirant la nonchalance d’un amour éperdu, au fil de rencontres parfois lunaires qui désarçonnent autant l’héroïne que le spectateur, ce mélo existentiel inconsolable, sublimé par ses chansons italiennes, nous écorche le cœur à vif. Sa sève philosophique, métaphysique suinte à travers Parthenope et ses proches les plus cérébraux jusqu'à nous perdre dans la déraison, l'interrogation, le bouleversement moral, la foi amoureuse que l'on ne peut maîtriser.
Et nous, spectateurs, quittons difficilement des yeux l’écran - comme elle, perdue dans ses pensées, dans la beauté de ses souvenirs, alors que s’annonce le générique - d’avoir vécu, deux heures dix-sept durant, une expérience émotive aussi trouble que bouleversante. Comme une fleur finalement fragile se rendant soudain compte qu’elle s’est fanée avec le temps.
Mais attention aux déchirants adieux que suscite la fin : quitter Parthenope, c’est perdre une amie, une femme, une muse, une maîtresse - insaisissable et aimée - que l’on n’a pas su retenir, glissant à travers les doigts comme une mémoire qui s’efface.
Viva il cinema italiano 💖
Gratitude Jean-Marc Micciche pour l'influence involontaire.
*Bruno
-----------------------------------------------------------------
"Parthenope - Naître au monde sans y appartenir"
Elle naît de la mer comme une apparition. Parthenope, sirène napolitaine, femme sans ancrage, silhouette toujours en décalage avec le monde. Sorrentino ne la filme pas comme un personnage, mais comme une vibration : le souvenir d’un été, l’ombre d’un amour, le battement sourd d’un regret.
Il y a dans ce film une beauté hypnotique, comme si chaque plan retenait son souffle. Et pourtant, derrière les dorures, la mer bleue et les visages d’hommes éblouis, Parthenope raconte une solitude indicible – celle d’une femme qui traverse l’existence sans jamais y trouver de prise.
Son malaise est discret, mais profond. Il suinte dans les silences, dans les regards qu’elle ne soutient pas, dans ses gestes suspendus. Elle vit, oui – mais à la manière d’un fantôme bienveillant. Ni colère, ni cris. Juste l’impression persistante que la vie se déroule à côté d’elle.
Et lorsqu’elle vieillit, que les mots deviennent des outils, que l’intellect tente de contenir ce qui lui a échappé, il est déjà trop tard. Reste la mémoire. Mais même celle-ci semble fuyante, noyée dans une mélancolie douce.
Parthenope, c’est l’histoire d’une femme qui ne parvient jamais à habiter sa propre vie. Une femme belle jusqu’à l’irréel, que le monde regarde mais ne comprend pas. Et que le film lui-même peine à cerner, comme si elle était toujours ailleurs – au bord du réel, au bord d’elle-même.
C’est aussi un chant funèbre pour les amours manqués, les décisions non prises, les instants qu’on n’a pas su retenir. Un poème en forme de vague, lent, somptueux, troublant. Il ne faut pas attendre de ce film un récit, mais une sensation : celle d’avoir frôlé quelque chose d’immense et de vide à la fois.
*Aurélie.
Sortie salles France: 12 Mars 2025
Distribution: Celeste Dalla Porta, Daniele Rienzo, Dario Aita, Silvio Orlando, Gary Oldman
mercredi 25 juin 2025
Amer de Hélène Cattet et Bruno Forzani. 2009. France. 1h30.
Expérience unique brouillant nos repères entre réalité et illusion, Amer se décline en néo-giallo atypique, à la virtuosité technique qui laisse pantelant. Si bien que, dans ce paysage cinématographique souvent estampillé sous-genre, le duo Hélène Cattet / Bruno Forzani l'adopte au premier degré auteurisant, avec une richesse métaphorique aussi déroutante que fascinante.
Une proposition infiniment ambitieuse, délibérément conçue pour nous extirper de notre zone de confort, avec un art consommé du stylisme à la fois sensoriel, olfactif, auditif, viscéral. Pour ce faire, ils misent sur un brio technique extrêmement chiadé, composant des cadrages alambiqués sur les corps, les statues, les visages filmés en plans serrés, afin de nous faire ressentir les émotions charnelles des personnages - particulièrement Ana, à la fois curieuse, craintive et susceptible.
Découpé en trois parties retraçant son enfance, son adolescence puis sa vie adulte, Amer narre la perte d’innocence d’Ana, depuis la mort de son grand-père jusqu’à son bouleversement émotif dans un corps de femme ; sa hantise du désir, sa peur de la mort, notamment en renouant avec un passé funéraire devenu labyrinthe.
Entièrement voué à cette imagerie baroque, extrêmement travaillée et d’une inventivité à couper le souffle (chaque plan est un travail d’orfèvre qui subjugue les mirettes), le duo Cattet / Forzani accorde peu de place aux dialogues - d’autant plus rares qu’on pourrait aisément les occulter, tant le travail sur le son, la partition italienne épurée et l’image prédominent, monopolisant l’écran avec un art pictural jamais vu jusqu’ici.
"Le Giallo mis à nu".
Ovni sensoriel d’une vigueur érotique vertigineuse qu’aucun concurrent ne saurait émuler, Amer est une expérimentation psychédélique d’une modernité autonome, qui ne plaira pas à tout un chacun. Or, la proposition circonspecte que nous offre le duo français relève du jamais vu, en matière de (néo) Giallo expressif. Il ne cesse d’intriguer, d’interroger, de fasciner au fil des révisions, avec un pouvoir émotif aussi trouble qu’incontrôlable.
Récompenses:
2010 : Grand prix du nouveau talent à CPH:PIX
2010 : Mention spéciale du prix de la critique, festival de Gérardmer
2009 : Prix du public, festival du Nouveau Cinéma
2009 : Meilleurs réalisateurs, festival du cinéma fantastique de l’université de Málaga
2009 : Prix Noves Visions, festival international du film de Catalogne
lundi 23 juin 2025
Le Rideau de Brume / Seance on a Wet Afternoon de Bryan Forbes. 1964. Angleterre. 1h56.
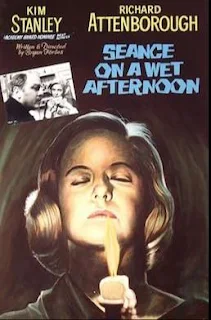
(Crédit photo : image trouvée via Google, provenant du site senscritique. Utilisée ici à des fins non commerciales et illustratives).