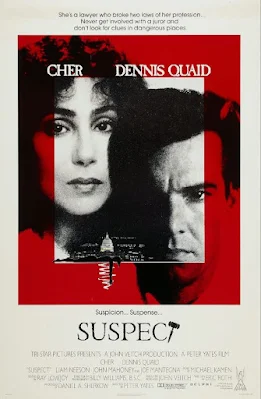Sortie salles France: 10 Avril 2019
FILMOGRAPHIE: Kevin Kölsch est réalisateur et scénariste. Il est connu pour Starry Eyes (2014), Simetierre (2019) et Holidays (2016).
Une déclinaison habitée par la Mort.
Implacable. On ne peut plus idoine. C’est bien un cauchemar implacable que nous livrent Kevin Kölsch et Dennis Widmyer - duo jusque-là inconnu, en dépit de Starring Eyes - avec ce remake sur lequel je n’aurais pas misé un clopet. Il m’aura d’ailleurs fallu quatre ans pour m’y risquer, poussé par les éloges de quelques vidéastes affirmant sans trembler qu’il surpasserait son modèle. Ce modèle, toujours aussi mal-aimé, donc infortuné. Et paradoxalement, ce remake que personne n’attendait (ou si peu) reste lui aussi boudé, comme frappé de la même malédiction que le Simetierre de Mary Lambert en 1989 - bien que défendu à l’époque par certains critiques passionnés, Mad Movies en tête.
Alors oui, n’y allons pas par quatre chemins - et j’ai peine à croire ce que j’écris - mais Simetierre version 2019 me semble, à moi aussi, supérieur à celui de 1989. Parce qu’il m’a provoqué un malaise diffus, rampant, opaque… Un venin distillé avec soin, malgré le fait que je connaisse l’histoire par cœur. La sagacité des cinéastes réside précisément là : renouveler un récit prévisible - grief déjà adressé à la version Lambert - en enrichissant sa narration. Topographie plus sinistre et photogénique du cimetière, présence accrue de la sœur moribonde de Rachel, relations plus ambivalentes entre Louis et son voisin Jud. Et surtout, des points de vue autrement plus dérangeants, plus viscéraux - à commencer par les apparitions de Zelda, aussi inconfortables que glaçantes, et par le jeu hypnotique de Jeté Laurence. Rarement une enfant ne m’aura autant terrifié : à la fois putride, maléfique, perfide, cynique, et pourtant traversée d’une étrange lueur d’humanité.
Le film suscite un malaise persistant en abordant à nouveau, avec finesse, les thématiques chères à Stephen King : la mort, l’antagonisme entre foi religieuse et athéisme, la douleur incommensurable du deuil - cette impossibilité d’accepter la perte. Ici, le regard se pose surtout sur l’athée, dont l’égoïsme, le refus de souffrir, l’effroi devant l’absence éternelle, le précipitent vers une damnation sans retour.
L’ultime demi-heure - malsaine, oppressante, presque hallucinatoire - m’a littéralement hypnotisé. Mise en scène avec lenteur, précision, une forme de science occulte. J’en suis venu à guetter, à espérer le générique final, comme une délivrance. J’en oublierais presque de saluer la réalisation, d’une grande rigueur formelle, où transpire un amour du genre à chaque plan. La direction d’acteurs, sobre, crédible, ancre les personnages dans un quotidien écrasé par la malédiction. Mention spéciale à John Lithgow, bouleversant en voisin hanté, même si Amy Seimetz, en mère endeuillée, s’efface un peu - par pudeur ou manque de présence.
C’est d’ailleurs ce qui fait la force de ce récit putride, désespéré, traversé d’un nihilisme radical. The Mist n’est pas loin - même sensation d’abandon, même dépression sourde transmise au spectateur, quand la Mort, ici patibulaire, s’infiltre dans chaque pore avec une lenteur méthodique. La violence, brutale, d’un réalisme gore mais jamais gratuit, blesse davantage par ce qu’elle laisse hors-champ que par ce qu’elle montre. Et que dire du chat, véritable miasme ambulant, dont la seule présence symbolise la contagion d’un Mal ancestral, incarné ici par le Wendigo - enfin expliqué de manière plus explicite.