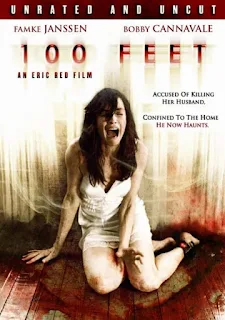(Crédit photo : image trouvée via Google, provenant du site senscritique. Utilisée ici à des fins non commerciales et illustratives).
Dilacéré aux quatre coins du globe, j’ai sciemment patienté quelques semaines avant de me lancer, histoire de laisser retomber le soufflet d’un bashing impitoyable.
Alors que je m’apprêtais à stopper la VHS après quinze minutes, quelle ne fut pas ma surprise — dès le générique extra-diégétique, dès ce prologue sardonique — de me laisser happer par ces clichés chers aux psycho-killers, vaguement ou franchement bonnards, qui pullulaient dans la sacro-sainte décennie 80.
Pur hommage aux modestes psycho-killers (moins aux chefs-d’œuvre notoires, au risque d’être déçu), Prom Queen se contente avant tout de chérir son amour pour ces séries B innocemment ludiques qui tapissaient nos murs de chambre et les étagères des vidéoclubs. On pense, entre autres joyaux plus ou moins obscurs, à Le Monstre du Train, Le Bal de l’Horreur, Happy Birthday, Les Yeux de la Terreur, Week-end de Terreur, Meurtres à la Saint-Valentin, Vendredi 13, Carnages, Humongous, Vœux Sanglants, Massacre au camp d'été et consorts.
Matt Palmer (déjà remarqué pour l’excellent Calibre en 2018) façonne ici un pur divertissement trivial, s’amusant des clichés avec une fantaisie et une désinvolture désarmantes de naïveté assumée. Et si les personnages gogos, notre héroïne un brin cruche, se contentent du minimum syndical pour une psychologie superficielle, leur comportement crétin, leur pointe d’humanisme candide réveillent la nostalgie de ces bobines horrifiques bâties sur l’exploitation de leur sort morbide. À ce niveau, Prom Queen ne déçoit pas : il bannit presque tout effet numérique au profit de maquillages mécaniques du plus bel effet sanglant. Même si le récit ne fait pas vraiment peur, l’ambiance anxiogène ou inquiétante, son petit charisme visuel, opèrent leur charme de fascination. Porté par un montage nerveux, le tout intensifie les actions furibardes pour un plaisir de fun immédiat.
Criant son amour aux années 80 sous entêtante impulsion électro, la bande-son pop qui résonne au bal maudit sert de juke-box exaltant pour une génération projetée d’un coup dans son insouciance — quand un tueur encapuchonné rôde dans l’ombre des couloirs avant de frapper, armé des lames (et outils électriques) les plus divers et improbables. Émaillé de clins d’œil tous azimuts — jusque dans les posters punaisés aux murs des chambres adolescentes — Prom Queen distille en filigrane, parfois avec ostentation, un humour noir qui rappelle que ce jeu de massacre se savoure au second degré.
Quant au final paroxystique, il régale les mirettes d’un carnage festif, directement inspiré de Carrie, avec en prime une série de rebondissements sur l’identité et les mobiles du présumé coupable. Un dénouement aussi jubilatoire que sciemment semi-parodique, porté par une inventivité narrative plutôt cohérente au regard de ses illustres aînés du psycho-killer bonnard.
Alors, à quoi bon bouder ce plaisir de gentil sale gosse ?
*Bruno